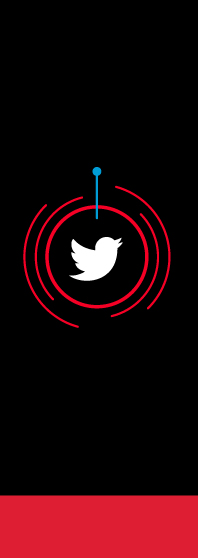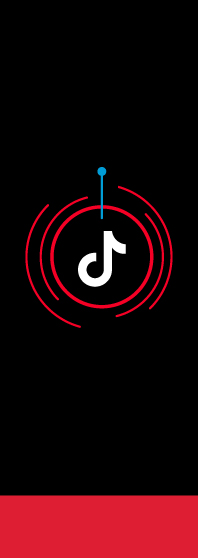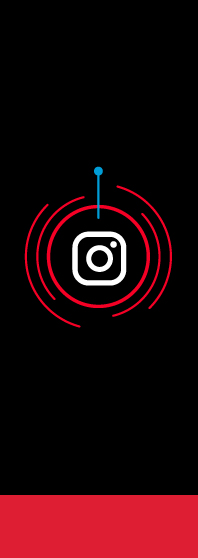Arsene Wenger, l'humaniste

Éduquer, entraîner, convaincre, vaincre. Voyage dans les méandres de l’âme du manager d’Arsenal. Ce jour-là, Arsène Wenger, qui fait la Une du nouveau Sport & Style, a envie d’entrouvrir pour nous la porte de son boudoir à angoisses et bonheurs.
Trêve internationale. Quelques jours d’évasion pour Arsène Wenger. Loin de London Colney, le camp d’entraînement d’Arsenal. Arsène en liberté. Quelque part entre Nice et Cannes. Quiétude. Un déjeuner entre amis à la Petite Maison, son repaire niçois. Un soupçon de football aussi. France-Arménie à l’Allianz Riviera. Arsène Wenger donne rendez-vous à l’hôtel Belles Rives, l’ancienne Villa Saint-Louis de Scott Fitzgerald. Écrivain et dandy. 10 heures du matin. Arsène est ponctuel. Shooting photo. Le ciel est clément. Une chambre, la 70, sert de dressing room. Wenger s’amuse à suivre les conseils de Cindy Sanchez, notre styliste.
Arsène, si je vous dit 6 945 et ce en date du 9 octobre, ça vous évoque quoi ?
Rien.
Ça fait 6 945 jours que vous êtes l’entraîneur d’Arsenal. Soit autant que le cumul des jours de présence des dix-neuf autres managers de Premier League.
Ah bon ? Et ça fait combien de secondes, vous qui êtes bon en maths (il rit) ?
Facile : 6 945 x 24 x 3 600 !
Pour moi, ça ne représente rien d’autre que le fait de pratiquer un métier exclusivement tourné vers l’avant. Vers le jour prochain. Je vis toujours dans le futur. Il est planifié. Serré. J’ai une relation au temps assez angoissante d’ailleurs. Je suis toujours en train de me battre avec. De ce fait, j’ignore totalement ce qui appartient au passé.
En quoi la minute qui arrive est-elle source d’angoisse ?
J’ai toujours peur d’être en retard. De ne pas être prêt. De ne pas pouvoir accomplir tout ce que j’ai planifié. Ma relation au temps est angoissante à tous les titres. Remonter le temps, se pencher en arrière est tout aussi vertigineux. Tout d’abord ça fait peur, parce qu’il n’y en a pas autant à venir que de vécu... La seule manière de lutter contre le temps c’est de ne pas trop regarder derrière soi. Si l’on s’y complait, c’est angoissant et parfois culpabilisant.
Vous utilisez le mot angoissant aussi bien pour évoquer demain qu’hier...
Le seul moment de bonheur possible, c’est le présent. Le passé donne des regrets. Et le futur des incertitudes. L’homme a très vite compris cela et a créé la religion. Elle lui pardonne ce qu’il a accompli de mal dans le passé et lui dit pour le futur de ne pas s’inquiéter, puisqu’il ira au Paradis. Ça veut dire profite bien du présent. L’homme s’est très tôt « auto-psychanalysé » via la foi.
Votre lucidité sur la relation de l’homme à la religion est très éloignée de votre regard adolescent sur la question. À l’époque, vous lisiez le missel pour aider votre équipe à gagner...
Malheureusement, aujourd’hui, ça marche moins ! En même temps, heureusement, ça veut dire que mon équipe n’a pas forcément besoin de Dieu pour gagner.
Dans votre relation au présent, au match, le manager se sent-il investi d’un pouvoir presque mystique ? Vous êtes le créateur de votre équipe, de son style de jeu, de sa stratégie.
Religieusement, on dit que Dieu a créé l’homme. Moi, je ne suis qu’un accompagnateur. Je permets aux autres d’exprimer ce qu’ils ont en eux. Je n’ai rien créé. Je suis un facilitateur de ce qu’il y a de beau en l’homme. Je me définis comme un optimiste. Mon combat perpétuel dans ce métier, c’est de sortir ce qu’il y a de beau en l’homme. On peut à ce niveau-là me dépeindre comme un naïf. En même temps, ça me permet d’y croire et ça me donne souvent raison.
Pas toujours...
Parfois, je n’arrive pas à générer le meilleur de ce que l’homme a en lui. Ça m’offre une opportunité d’analyser là où j’ai failli.
Vous dites qu’on vous dépeint comme un naïf. Ne préférez-vous pas plutôt être qualifié d’idéaliste ?
Un mec a dit : « il n’y a qu’une seule façon de vivre avec l’idée de mort, c’est d’essayer de transformer le présent en art ». Ça rejoint tout ce dont on vient de parler.
L’art n’est pas forcément source de beauté universelle. Des œuvres peuvent plaire ou choquer selon la relation de chacun à la beauté.
J’ai choisi un sport collectif. Il y a une magie quand les hommes unissent leurs énergies pour exprimer une idée commune. Alors là, le sport devient beau. Le malheur de l’homme vient lorsqu’il se trouve seul à lutter contre les problèmes auxquels il doit faire face. Surtout dans la société moderne. Le sport collectif a une valeur, c’est de pouvoir être en avance sur son temps. On peut jouer avec onze joueurs de onze nationalités différentes et proposer une œuvre collective. Le sport d’aujourd’hui peut démontrer ce que peut être le monde de demain. On peut ainsi partager des émotions fantastiques avec des gens avec qui on ne peut pas parler. Ce n’est pas encore possible dans la société du quotidien. Et dans ce sens, le sport collectif est un modèle. Quand le tennis devient Coupe Davis, il porte en lui quelque chose qui n’existe pas autrement. Le golf avec la Ryder Cup aussi. Les gens le ressentent. La vibration est là.
Auriez-vous pu être entraîneur dans un sport individuel ?
Je ne crois pas. Aller au fond de l’individu, voir ce qui le motive, m’intéresse aussi énormément. Mais j’ai été élevé dans le sport collectif et ma psyché s’est construite comme ça. Coach d’un seul athlète m’aurait frustré. C’est lié à mon éducation. Dans mon village, on ne jouait qu’au foot ou au basket.
Avoir été un joueur pro, mais pas un grand joueur, vous offre-t-il plus de mansuétude, de patience, par rapport à ce que votre équipe ne peut accomplir ?
On peut expliquer cela par la relation à la frustration d’un joueur qui n’a pas pu parvenir à ce qu’il ambitionnait. Quoi qu’il arrive, quelle qu’eût été ma carrière, je serais resté dans le foot. Le foot a été pour moi une évidence. Une évidence un peu folle. Il y a des moments, quand j’avais 24-25 ans, je me disais : putain, si je ne peux plus jouer au foot, je me suicide ! Je me disais : quel est le sens de la vie après ?
Sérieusement ?
Sérieusement. J’ai longtemps essayé de comprendre comment on pouvait être aussi bête. Tout simplement parce que j’ai été élevé dans un restaurant-bar qui était le QG du club de foot. On ne parlait que de foot. Les mecs faisaient l’équipe le mercredi et le jeudi pour le dimanche. Je marchais à peine que déjà je les regardais, je les écoutais. Et je me disais : ouah, ils veulent mettre celui-là ailier gauche, eh ben on va encore avoir du mal à gagner.
Vous êtes vite intervenu dans ces discussions ?
Ah oui. Vers 4-5 ans je conscientisais ces discussions et j’ai commencé à m’en mêler vers 9-10 ans. J’étais enfermé dans une culture où, inconsciemment, je pensais que seul le foot était important dans la vie. Parce que les gens ne parlaient que de ça.
Face à vos angoisses des 24-25 ans, comment vous êtes-vous sécurisé, rassuré ?
En fait, ça a été progressif. À 25-26 ans, je suis allé donner une conférence à Mulhouse avec l’un de mes copains qui était conseiller technique. Il m’a proposé de former des moniteurs. Le processus de transformation s’est donc mis en place progressivement. Puis mon entraîneur de foot à Strasbourg, Max Hild, m’a dit : « viens au centre de formation avec moi ». J’y suis allé et je suis devenu son adjoint. Et comme il est vite devenu entraîneur des pros, j’ai été promu directeur du centre de formation à 30 ans. À 32 ans je n’ai plus fait que ça, j’ai arrêté de jouer en parallèle. Et puis après, tout est allé très vite. Je n’ai pas eu le temps de me poser de questions existentielles. Les aspirations s’adaptent au potentiel physique pour commencer. Je savais que je pourrais jouer au foot éternellement.
Vous projetez-vous aujourd’hui sur votre fin de carrière de coach ? Une nouvelle petite mort. Vous venez d’avoir 66 ans.
J’ignore totalement cette question. Je suis un peu comme le mec qui a 34 ans et joue encore. Il fait un mauvais match et on lui dit : « eh ça va, il faut arrêter mon gars ! ». Je ne me pose même pas la question de ce que je ferai après, parce que ça va être un choc extrêmement dur. Beaucoup plus dur que lorsque je suis passé de joueur à entraîneur. Parce que là, il s’agira de passer de l’hyperactivité au vide. C’est pour ça que je refuse de me poser la question. Je suis comme un mec qui n’est pas très loin du but, qui continue d’avancer, et qui ignore le mur. Là, si je vous dis Erik, vous n’avez que 24 heures à vivre. Vous allez imaginer le couperet qui va vous trancher la gorge – et ce pendant les 24 heures qui vous restent – ou simplement essayer de les vivre pleinement ? C’est la question de la fin de vie en fait.
L’exemple réussi d’Alex Ferguson qui, à 71 ans, s’est brutalement arrêté pour répondre à la demande de son épouse qui était en détresse après avoir perdu sa sœur vous inspire-t-il ?
Pour moi, à ce niveau, Ferguson est un exemple. Déjà, il a toujours su se renouveler, évoluer. Il n’est pas resté figé dans le succès. C’est une qualité que j’apprécie chez lui. Il a tout le temps su se remettre en cause. Même s’il l’a fait instinctivement. Mais il avait des passions partagées. Il aimait les chevaux. Le vin. Il connaît mieux le vin rouge que moi. Récemment, je l’ai rencontré et je lui ai dit : « Alex, ça ne te manque pas ? ». Il m’a répondu « pas du tout ». J’ai été à la fois déçu et réconforté. C’est un motif d’espoir pour moi.
Vous n’avez pas de passions annexes ?
Non. C’est de là que naît mon angoisse naturelle. Je ne suis pas Ferguson. Je n’ai pas de substitut et je ne suis pas non plus intéressé à l’idée de regarder en arrière. Comme écrire un livre sur ce qui m’est arrivé. Je vis comme une souffrance les anciens joueurs qui viennent me voir et qui ne sont plus pleinement heureux. Être présenté comme Mr X, ancien joueur d’Arsenal, et pas pour ce qu’il est aujourd’hui est douloureux. Être ce que tu as été est une souffrance. J’espère, dans ma vie d’après, pouvoir être autre chose que l’ex-entraîneur d’Arsenal. Entraîner des jeunes. Être utile.
Pourquoi ne gardez-vous rien de votre passé ?
Ça m’inquiète un peu. Si vous venez chez moi, vous ne pourrez jamais deviner que vous êtes chez un entraîneur de foot. Si vous me demandez où est la médaille de ma dernière FA Cup, je ne peux pas vous le dire. Je pense l’avoir donnée au médecin du club ou au responsable du matériel.
C’est paradoxal pour le manager d’un club qui a un sens aigu de l’histoire et de la transmission.
Je m’intéresse énormément à l’histoire des autres. La mienne me concerne beaucoup moins. Parce que je la connais et que de ne pas la revisiter me permet d’ignorer toutes les conneries que j’ai faites dans ma vie. Ça évite la culpabilité. J’ai toujours trouvé un peu pathétiques les mecs qui font visiter leur musée et racontent ce qu’ils ont fait de grand dans leur vie.
Qui d’autre que vous pour laisser une empreinte de votre parcours professionnel ?
Mon club le fera très bien. Les médias sont tellement développés aujourd’hui qu’ils raconteront aussi une histoire de moi, même si elle ne sera pas forcément « mon » histoire. La vraie est sans doute plus intéressante parce que beaucoup de choses sont ignorées sur ce qu’il m’est arrivé. Mon père, par exemple, collectait tout ce qui s’écrivait sur moi. Parfois, j’ai l’impression de le trahir. Parce que je ne m’y intéresse pas. Peut-être que ça changera. Un jour, qui sait, je me dirai peut-être : mon ami, il est temps de faire le point sur ce qui est arrivé.
Raconter pour mieux transmettre ?
La plus grande beauté de mon métier, c’est de pouvoir transmettre et influencer la vie des autres. De façon positive.
Comment vivez-vous le fait d’être statufié de votre vivant comme Sir Alex Ferguson ou Thierry Henry ?
Je suis un peu mal à l’aise avec ça. Je préfère me battre chaque jour pour convaincre l’opinion que ce que je fais n’est pas trop mal. Aujourd’hui, on est très vite remis en question. Ce qui a changé dans nos métiers, c’est que le crédit accumulé ne protège de rien. On est sans cesse obligé de se battre pour être respecté.
Il est plus dur pour un entraîneur moderne de convaincre que de vaincre ?
Pour vaincre, il faut convaincre. La société est passée de la verticalité à l’horizontalité. Un entraîneur en 1960 disait « les gars, on fait comme ça » et personne ne discutait. Aujourd’hui, il faut d’abord convaincre. Le joueur est riche. La caractéristique du riche c’est d’abord la nécessité de devoir le convaincre. Parce qu’il a un statut. Une façon de réfléchir. Les gens aujourd’hui sont informés. Ils ont donc une opinion. Et pensent que leur opinion est la bonne. Ils ne partagent pas forcément la mienne, donc je dois les convaincre.
Il vous a fallu dans un premier temps à Arsenal convaincre le club et les fans de suivre vos préceptes.
Arsenal est un club de tradition qui n’a pas peur d’innover.
Parce que vous et David Dein, alors vice-président d’Arsenal et avant tout votre ami, avez bousculé les traditions.
Ils n’ont pas eu peur de me suivre. C’est un véritable acte de courage.
Ils vous ont surtout donné du temps. Vous entamez votre vingtième année à Arsenal.
Le temps est le vrai luxe. Je me reconnais un mérite : j’ai toujours traité Arsenal comme s’il m’appartenait. On me l’a parfois reproché. Parce que je ne suis pas assez dépensier. Pas assez insouciant. Je me reconnais le courage d’avoir appliqué mes idées et de me battre pour elles. Après, je peux comprendre que des gens ne soient pas d’accord. Ma grande fierté sera de me dire que le jour où je partirai, je laisserai une bonne équipe, une situation saine et un club capable de performer dans le futur. J’aurais pu me dire : je suis là pour quatre ou cinq ans, on gagne tout, je pars et je laisse le club au bord de l’asphyxie. Pour moi, la constance dans le haut niveau est la marque des grands clubs. Le Real Madrid avant l’arrivée de Di Stefano en 1953 est bien resté 21 ans sans être sacré champion d’Espagne.
Au Real Madrid aujourd’hui, vous pouvez être sacré champion et être viré quand même...
Ils sont rentrés dans le circuit moderne. Il faut donner des nouvelles têtes. L’addiction aux news. Pour moi, la constance dans les résultats dépend de la cohésion au sein du club. Jeter tout, tout le temps, n’a de sens que si on a des moyens hyper illimités. Là, on peut gagner. Sinon, on passe à la casserole.
Vous parlez de constance et de patience. Quand vous étiez entraîneur de Monaco, vous étiez plutôt du genre volcanique.
J’ai mûri. Je suis passé par le Japon. J’ai appris à me maîtriser. J’ai une hyper sensibilité que j’ai petit à petit disciplinée. J’ai commencé à entraîner vraiment à 33 ans, j’en ai 66. Pour survivre j’ai dû m’adapter.
Vous y auriez laissé votre santé sinon ?
Non. J’ai toujours été prêt à payer le prix avec ma santé de façon assez bête, mais plutôt le prix de la survie dans le métier. Parce que je me suis aperçu que je pouvais causer des dommages irréparables après les matchs.
Votre passage au Japon où vous avez entraîné Nagoya Grampus Eight (1994-1996) vous a profondément changé.
Mon président, Shoichiro Toyoda, m’a dit qu’il rêvait de faire de Nagoya le plus grand club du Japon et du monde d’ici à 100 ans. Ça supprime la pression de l’immédiat d’une façon fantastique. Que devient une défaite si vous projetez votre destinée sur la sécularité ? Ensuite, j’ai trouvé l’idée extrêmement généreuse. N’être dans l’histoire qu’une courroie de transmission, au sein d’un mouvement qui est bien plus grand que toi. Faire partie d’un tout qui vous dépasse. On vit hélas trop souvent avec l’idée que le monde va s’arrêter après nous. Ce n’est pas ça l’humanité. Il y a une forme de scientisme là-dedans. Porteur d’espoir d’un destin de l’humanité toujours meilleur. On peut le questionner aujourd’hui...
C’est le moins que l’on puisse dire...
Nagoya l’a d’ailleurs remis en question (il rit). Ils ne sont pas beaucoup plus loin qu’au moment où je les ai quittés. Cela dit, ça ne fait que vingt ans. D’ailleurs, le président Toyoda est de retour et ils reviennent me voir pour que je leur donne des conseils. Tous les mois pratiquement. Je suis toujours très proche d’eux.
Tout à l’heure, en vous regardant vous habiller pour le shooting photo, m’est revenue cette réflexion de Mircea Lucescu, l’entraîneur du Shakhtar Donetsk, à votre propos : « Arsène est un aristocrate. Il n’est pas porté par les valeurs ouvrières d’un Alex Ferguson ou par l’esprit agressif d’un José Mourinho. Il cherche à éduquer avant tout ». Vous reconnaissez-vous dans ce portrait ?
Je ne nie pas être avant tout un éducateur. En revanche, je ne me sens pas du tout aristocrate. Si vous aviez vécu avec moi à charger du fumier sur les charrettes, vous auriez compris. J’essaie d’être fidèle aux valeurs que je trouve importantes dans la vie et de les transmettre aux autres. En trente ans de carrière de coach, je n’ai jamais fait piquer un de mes joueurs pour qu’il soit plus performant. Je ne lui ai jamais donné un produit qui puisse améliorer sa performance. C’est une fierté. J’ai joué contre beaucoup d’équipes qui n’étaient pas dans cet état d’esprit.
L’aristocratie est un état d’esprit, pas forcément une transmission de sang.
Je ne nie pas ce que ressentent les autres, mais moi je me ressens comme un gamin de Duttlenheim qui allait courir dans les champs tous les jours. Et puis les aristocrates, on leur coupait la tête chez nous. Ce que je revendique, c’est la transmission des valeurs. Pas le droit du sang. Une civilisation qui n’honore plus ses morts ni ses valeurs est condamnée à disparaître.
Justement, vous êtes en Angleterre et vous n’avez pas gardé la tenue des champs. Vous êtes toujours impeccable sur le banc les jours de match.
Parce que je me sens responsable de l’image que donne le foot et de l’image que je veux donner de mon club. Et en même temps, le foot est une fête. Or, chez moi, quand j’étais gamin, on s’habillait le dimanche. J’ai adoré, en arrivant en Angleterre, voir les managers porter costard et cravate. Comme pour dire « écoutez les gars, notre objectif est de faire de ce moment une fête ». J’ai adhéré. J’ai envie que le mec se réveille le matin en se disant, Arsenal joue aujourd’hui, je vais passer un bon moment. Ce mec-là commence sa journée en se disant que quelque chose de sympa va lui arriver. Et pour ça, les grands clubs doivent avoir l’ambition de donner du spectacle. D’un bonheur partagé. On n’y arrive pas toujours.
Passer une bonne journée à l’Emirates Stadium n’a plus grand-chose à voir avec une bonne journée à Highbury, votre ancien stade, non ?
L’exigence est devenue beaucoup plus importante. La définition philosophique du bonheur, c’est la concordance entre ce que vous souhaitez et ce que vous avez. Et ce que vous souhaitez se déplace à partir du moment où vous l’avez. Toujours plus. Toujours mieux. D’où la difficulté de satisfaire. Un supporteur d’Arsenal, quand vous finissez quatrième, il vous dit : « hey, ça fait vingt ans qu’on est dans le Top 4. On veut gagner la Premier League ! ». Ils s’en foutent que Manchester City ou Chelsea aient investi 300 ou 400 millions d’euros. Ils veulent juste les battre. Mais si vous finissez quinzième pendant deux ans, ils seront heureux si vous terminez quatrième après.
Il n’y a pas que les fans qui sont impatients. Même Thierry Henry a déclaré sur Sky Sports : Arsenal « must win », doit être champion cette saison.
« Must » c’est valable pour mourir. On « doit » tous mourir un jour. Je préfère dans ma vie remplacer « must » par « want ». Vouloir plutôt que devoir. Si vous me dites, il faut que vous sortiez ce soir, j’ai déjà moins envie de sortir. Si vous me dites est-ce que vous avez envie de sortir ? Ah oui, j’ai envie ! C’est là qu’est le goût de la vie. « Must », « must »... « Must » rien pour moi.
Au moins, ça c’est fait...
Pour moi, la beauté du sport c’est que tout le monde veut gagner, mais il n’y aura qu’un vainqueur. Vous mettez vingt milliardaires à la tête des vingt clubs anglais, il n’y aura qu’un champion et dix-neuf déçus. Mon grand-père me disait : « Je ne comprends pas, au 100 mètres, il y en a un qui court en 10’’1 secondes et l’autre en 10’’2, les deux sont rapides. Ça sert à quoi tout ça ? ». Aujourd’hui, on va glorifier celui qui court en 10’’1 secondes et traiter de nul celui qui court en 10’’2 secondes. Or ils courent tous quand même très vite. C’est très dangereux pour le sport. On est passé dans une ère où l’on glorifie celui qui gagne quels que soient la méthode et les moyens. On se rend compte dix ans après que le gars a triché. Et le deuxième pendant ce temps-là, il a souffert. Il n’est pas reconnu. Et que n’a-t-on pas dit sur ces deuxièmes... Ils ont de quoi être malheureux.
Vous revendiquez le « jouer fair-play », êtes-vous en ce sens un véritable Anglais ?
Je n’ai pas toujours été fair-play. Il y a en chacun de nous le désir de gagner et la haine de la défaite. J’ai eu beaucoup de mal parfois à être extrêmement fair-play face à ma haine absolue de la défaite. Tiens, à ce propos, je reste le seul entraîneur à avoir gagné un championnat d’Angleterre sans avoir perdu le moindre match. Mais les Anglais ont quelque chose en plus côté fair-play. Regardez les rugbymen éliminés en poule chez eux qui font une haie d’honneur aux Australiens qui viennent de les sortir. Là, je dis respect ! Tu sais combien ils souffrent. Combien ils subissent en direct l’humiliation. C’est quand même une belle image du sport. Ce que j’aimais beaucoup dans le sumo au japon, c’est qu’à l’issue du combat le vainqueur ne montre jamais sa joie pour ne pas humilier le perdant. J’ai énormément souffert dans la défaite. Quand je vois certains comportements et l’excès dans certains pays, je trouve remarquable ce que véhicule la culture japonaise ou le sens des valeurs des Anglais.
En quoi êtes-vous définitivement devenu anglais ?
C’est le pays du cœur. Il n’a pas peur de l’émotion. En anglais, on va te dire
« I love it ! ». Nous, on se pollue l’émotion par l’esprit cartésien qui nous anime. On ne sait pas aimer sans compter. On aime le PSG, mais... Les Anglais savent se lâcher dans l’émotion.
Nombre d’anciens Gunners ont construit leur après-carrière de foot en Angleterre tels Robert Pirès, Patrick Vieira ou Thierry Henry. Resterez-vous éternellement un Londonien ?
Je n’ai pas décidé. Ce qui est sûr, c’est que mon attachement à Arsenal restera jusqu’à la fin de mes jours. J’ai eu des moments de rupture que j’ai toujours refusés. Je ne me vois pas aujourd’hui faire une carrière d’entraîneur ailleurs.
Sûr ?
Presque sûr (il rit). Si demain matin on me dit au revoir et merci à Arsenal, je ne peux pas jurer que je ne chercherai pas à continuer à travailler, à vivre ma passion. Mais sans doute pas en Angleterre.
À éduquer plus qu’à entraîner ?
Je ne veux surtout pas qu’on mette l’envie d’être éducateur en contradiction avec l’envie de gagner. C’est faire passer l’éducateur un peu pour un con. La démarche de tout entraîneur au départ doit être d’éduquer. L’une des beautés de notre métier, c’est de pouvoir influencer positivement le cours de la vie d’un homme. Vous, comme moi, nous avons eu la chance de rencontrer des gens qui ont cru en nous et nous avons avancé. Les rues sont pleines de gens pétris de talent mais qui n’ont pas eu la chance qu’on leur fasse confiance. Je peux être celui qui facilite la vie, qui donne une chance.
Et lorsqu’en match, sur le banc d’à côté, vous êtes confronté à un entraîneur pour qui seul le résultat compte, Peu importe les moyens...
On m’a traité parfois de naïf à ce niveau-là. De toutes façons, il n’y a qu’une manière de pouvoir vivre sa vie. Être en conformité avec les valeurs qui vous semblent importantes. Si je ne les respecte pas, je serai malheureux. Quoi qu’il en soit, j’aurais toujours été totalement un homme qui s’est engagé pour la cause. Avec mes bons et mes mauvais côtés.
S’il vous reste un moment fort dans votre carrière ?
Être arrivé à Londres dans le scepticisme le plus total. Mon premier titre de champion, mon premier doublé. De « Arsène who » à celui qui est devenu un pionnier. Le premier entraîneur non britannique à s’imposer en Angleterre
Et s’il y a une douleur ?
Devoir, au moindre match perdu et malgré la constance que l’on a mis dans son travail au plus haut niveau, être totalement remis en question dans tout ce qui a été fait. Le « tout-à-jeter » immédiat. Il faut trouver un équilibre entre ta capacité masochiste à supporter ce qu’on te fait subir et le plaisir de l’accomplissement. Or, aujourd’hui, ma capacité masochiste doit être plus importante pour pouvoir exprimer ma passion. J’en suis à ce point-là. Je fais beaucoup de choses qui me font souffrir.
C’est pour cela que vous vous éloignez des médias ?
Évidemment. Vous connaissez quelqu’un qui se lève le matin en disant : tiens, j’ai envie de prendre cinquante coups de fouet ?