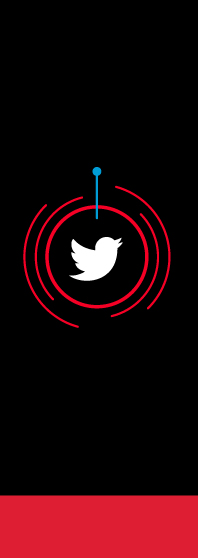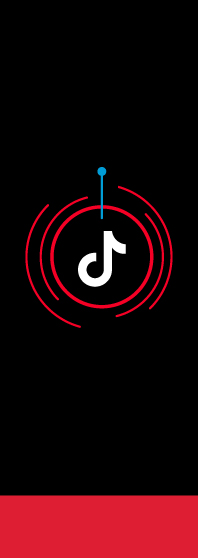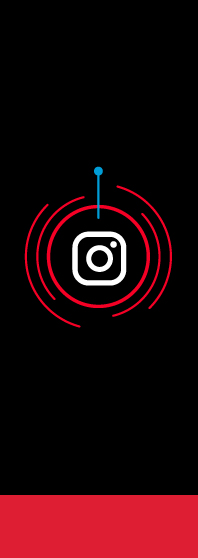‘’La production maraîchère et fruitière dans cette zone a bouleversé le traditionnel alimentaire’’

Lorsqu’elle a été lancée en 2005/2006, beaucoup pensaient que c’était un des éléphants blancs d’Abdoulaye Wade. 10 ans plus tard, la grande muraille verte prend forme, même si c’est timidement. Si l’on en croit le directeur de l’agence qui lui est dédiée, le colonel Pape Waly Guèye, ce programme a bouleversé les habitudes alimentaires de certaines zones du Ferlo. Les écoles retrouvent également leurs élèves grâce à une sédentarisation progressive. N’empêche, les difficultés sont là et bien réelles.
La grande muraille verte a aujourd’hui un peu plus de 10 ans, quel est le bilan que vous pouvez en tirer ?
Au-delà des activités de reboisement, le bilan est très important sur le plan socio-économique. Car la grande muraille verte, ce n’est pas seulement une bande de verdure. Ce sont aussi des activités génératrices de revenus. Si vous connaissez un peu le Ferlo, depuis des siècles jusqu’à tout récemment, l’activité principale, c’est l’élevage. A part le bétail, on n’avait pas d’autres préoccupations. Aujourd’hui, dans cette zone, le contexte socio-économique a évolué, sinon changé. Avec les activités génératrices de revenus dans chaque gros village où passe la Grande muraille verte, nous aidons les femmes et les jeunes à faire ce que nous appelons un jardin polyvalent villageois qui a un minimum de 5 hectares.
Nous nous sommes plus ou moins appuyés sur des réalités de développement qui se sont passées en Israël, en Libye où en plein désert, on a pu faire de l’agriculture quand on a l’eau. On s’est basé sur ces expériences scientifiques pour faire des jardins en plein Ferlo. Les populations étaient ahuries quand elles nous voyaient tenter de faire de la salade, de la tomate et du maraîchage en plein Ferlo. Au-delà de ces activités maraîchères, on a pu intégrer des activités d’arboriculture. Dans les sites de la Grande muraille verte, entre Keur Momar Sarr, Mbar Toubab, Labgar (région de Louga), vous verrez une production d’oranges, de citrons et même de mangues. Les populations locales se décrochent de plus en plus de l’activité pastorale, pour faire des activités agricoles.
La production maraîchère et fruitière dans cette zone a bouleversé le traditionnel alimentaire. Ceux qui se contentaient de produits laitiers, de couscous et de riz, ont maintenant une alimentation améliorée. Sur tous les plans dans ces zones, on voit qu’il y a des légumes, on y trouve une augmentation de la valeur nutritive. Des chercheurs de haut niveau qui nous accompagnent ont fait des études approfondies sur cela. Beaucoup de thèses qui ont été faites sur les impacts socio-économiques de la Grande muraille verte l’ont confirmé.
Vous l’avez dit, l’activité principale est l’élevage. Qu’avez-vous apporté à ce niveau ?
L’élevage est le premier bénéficiaire puisque les parcelles reboisées sont clôturées et surveillées. Elles deviennent ainsi des banques fourragères à partir du mois de mai jusqu’au mois de juillet. Autour de ces parcelles, il arrive des moments où sur des dizaines, vingtaines ou bien des centaines de kilomètres, tu ne verras pas de paille. Tout est raclé par le bétail et il faut aller à l’intérieur des parcelles pour trouver de la paille en très grande quantité et de très bonne qualité. Nous les appelons les banques fourragères. Elles sont gérées par les populations elles-mêmes.
Chaque année, il faut un arrêté de l’autorité administrative de la zone concernée pour qu’entre le 15 et le 30 mai, on puisse ouvrir ces parcelles. Il faut payer 1 000 F CFA ou 500 F CFA par charrettes remplies de paille ou bien, ce sont des cotisations annuelles où chaque famille donne 3 000 F CFA par an et va récolter selon ses besoins. Ce sont des retombées et des impacts extrêmement importants par rapport aux activités que nous menons dans la zone. Donc les activités vraiment, c’est l’accompagnement en plus des plantations sur 5 000 ha par an et des activités de maraîchage, d’apiculture, d’arboriculture.
On sait que les Peuls, du fait des activités pastorales, sont des nomades. Est-ce que la sédentarisation se fait dans vos zones d’intervention ?
Oui ! Je dois dire même que nous sommes en train de faire de bons résultats dans le domaine de l’Education. Dans les écoles des zones d’intervention, on a constaté des changements très positifs. A chaque fois que nous venions dans une zone, l’école était presque fermée, non pas faute d’enseignants mais faute d’élèves. Vous voyez dans cette zone du Ferlo, à un certain moment avec le nomadisme ou la transhumance, les pasteurs s’en vont en grande partie pour aller dans le sud du pays à la cherche de l’aliment de bétail. Et quand la famille bouge, les enfants s’en vont. Dans certains villages, vous pouvez voir un enseignant qui, il y a cinq ans de cela, avait dans sa classe moins de dix élèves. Vous pouvez avoir dans ces zones des moments où deux ou trois enseignants dans une école n’arrivent pas à réunir une population scolaire de plus de 50 élèves dans toute l’école.
Aujourd’hui, ça a changé puisque les femmes ont des activités autres que de vendre du lait et de suivre le bétail. Les hommes, heureusement, trouvent des banques fourragères où ils peuvent alimenter le bétail, et les enfants restent quand les mamans restent. Donc, le taux de scolarisation a repris. La moyenne de présence est de 25 élèves par classe. Alors qu’il y a des moments où c’était moins de 10 élèves par classe. On a constaté d’ailleurs qu’il y a plus de filles que de garçons. Les conditions n’étant pas encore réunies pour une sédentarisation définitive, les garçons sont sollicités pour le déplacement des troupeaux.
Quelles sont les difficultés majeures auxquelles vous faites face ?
Il y a le problème de la maîtrise de l’eau (voir texte) et la grille de clôture. Nous avons beaucoup de difficultés avec la grille qui est pourtant essentielle. D’abord la clôture coûte cher. Il faut 120 à 130 millions pour acquérir la clôture. Si on tient compte du coup d’acquisition de la clôture elle même, plus les poteaux et la main d’œuvre, ça fait 2 millions par kilomètre. Chaque année, nous essayons de faire 100 km. Or, depuis 5 ans, les 100 km par an connaissent des retards importants. Avec la procédure actuelle de la passation des marchées, de l’ARMP, on ne peut dérouler un marché d’achat de clôture en moins de 7 mois. Et pendant ce temps, la pluie, elle, n’attend pas. Et pourtant, nous lançons le processus à partir de mi-janvier début février.
Malgré tout, c’est au cours de l’année que nous arrivons à avancer sur le marché. Et là, c’est à condition qu’il n’y ait pas de difficultés lors de la procédure, puisqu’il peut y avoir un litige. Il se peut qu’il y ait un recours d’un soumissionnaire. Et dans de pareils cas, on reprend tout. C’est aussi une grosse difficulté. Même si on a un budget conséquent, les procédures pour disposer de ce budget et avoir les clôtures nous prennent plus de temps de telle sorte que, souvent, on est en retard par rapport à la date de plantation. Nous nous contentons très souvent des clôtures des années précédentes.
Au début du projet, avez-vous rencontré la résistance des populations ?
La résistance oui mais bizarrement, résistance après action. L’une des résistances que j’ai vécues sur le terrain est que quand nous étions dans la commune de Téssékré où on a eu à faire de belles réalisations, l’une de nos plus grosses parcelles qui fait 1 200 hectares et qui date de 2008 devait être transformée en réserve naturelle, une réserve de faune comme la réserve de Bandia. La population, au départ, était d’accord. Quand les choses ont commencé à se matérialiser, elles se sont senties un peu lésées, se sont rebiffées parce qu’elles ne pouvaient plus y conduire leur bétail. Ce qui a fait qu’à un certain moment, on a dû laisser tomber ce programme. Heureusement, nous avons trouvé un site mieux placé dans la vallée morte du Ferlo dans un village mythique appelé le village de Kouylé Alpha. Nous sommes en train d’installer cette réserve de faune qui, d’ici 5 ans, va pouvoir se comporter comme celle de Bandia.
L’Etat vous alloue un budget de 1 milliard par an. N’est-ce pas trop faible pour un projet aussi ambitieux ?
Mais il faut faire avec ce que l’on a. Nous, à l’Agence, en tenant compte des moyens de l’Etat du Sénégal, je crois que nous ne pouvons que nous en réjouir. Il faut traiter le problème dans un contexte global. Il y a des services qui, peut-être, ont les mêmes ambitions que nous, et peut-être n’ont pas la moitié de ce que nous avons. Par rapport aux efforts de l’Etat, il faut s’en féliciter. Au-delà des budgets de l’Etat, nous sommes en partenariat avec des partenaires techniques et financiers et, avec l’appui de l’Etat, nous sommes en train d’avoir des projets d’accompagnement.
BABACAR WILLANE