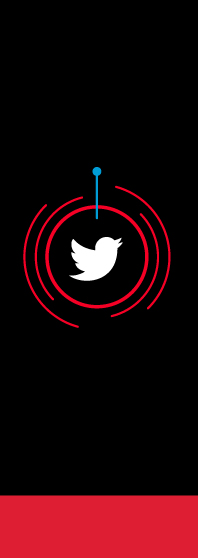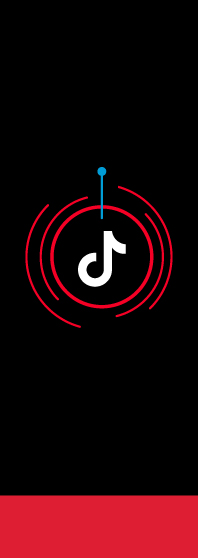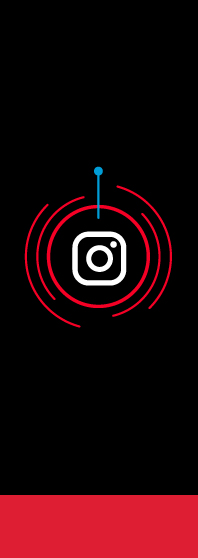‘’L’addiction est une maladie du cerveau et non une délinquance’’
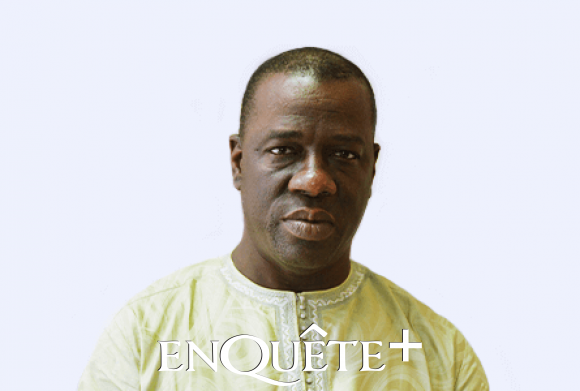
La répression et la stigmatisation rendent difficile la prise en charge des consommateurs de drogue. Sans oublier le manque de moyens. Même si le Sénégal s’est doté d’un centre spécialisé, il n’a reçu, en deux ans, que 400 patients sur une population estimée, en 2011, à 1324 individus. D’où l’appel du psychiatre et addictologue, Dr Idrissa Ba, coordonnateur technique du Cpiad.
Quel est le rôle du centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar (Cpiad) ?
Le Cpiad est une unité du service de psychiatrie de Fann dédiée à la prise en charge des personnes dépendantes des substances psychoactives. C’est-à-dire des personnes qui consomment des drogues. Quels que soient les types, il y a une prise en charge qu’on propose aux patients. Il y a également tout un tas d’activités qu’on leur présente. On prend en charge les personnes qui veulent être aidées, soit pour arrêter les produits, soit pour prendre en charge les problèmes des troubles psychologiques liées à la consommation des drogues.
A combien peut-on estimer le nombre de consommateurs de drogues injectables ?
Nous n’avons pas encore fait une étude au niveau national. Il y a une seule enquête qui a été faite, en 2011, sur les usagers de drogue dans la région de Dakar. Celle-ci a estimé la taille de la population de consommateurs de drogues injectables (c’est-à-dire ceux qui consomment l’héroïne, la cocaïne ou le crack, quel que soit le mode d’administration) à 1 324 individus vivant dans la précarité. Cette année, nous avons finalisé une enquête à Mbour, mais les résultats ne sont pas encore disponibles. On est en train d’analyser.
Certainement, d’ici la fin de l’année, les résultats vont être disponibles. Nous préparons aussi une autre enquête dans le cadre d’un programme régional appelé Pareco géré par l’Ancs, une autre enquête dans la banlieue et la ville de Kaolack. Ces 1 324 personnes ne sont pas encore prises en charge. Ce qui veut dire qu’il y a des efforts à faire. Récemment, nous avons fait le point sur nos trois ans d’activités, parce que le Cpiad a démarré en 2015. De 2015 à décembre 2017, nous avons reçu près de 400 consommateurs de drogues injectables. Vous voyez que le gap est énorme par rapport à l’estimation de taille. C’est un gap de plus de 800 patients à toucher. Donc, il faut qu’on essaie de pérenniser cette activité ou même de la renforcer pour pouvoir atteindre le maximum de ces personnes qui sont parfois difficiles d’accès.
Quelles sont les stratégies pour combler ce gap ?
Nous sommes en train de faire beaucoup de plaidoyers au niveau du cadre juridique, parce que nous avons des lois qui sont assez dures par rapport à la consommation de drogue et qui poussent les populations à se cacher. Nous avons fait un important travail avec le comité interministériel de lutte contre la drogue avec l’élaboration d’un plan stratégique qui est en train d’être mis en œuvre. Nous travaillons dans le sens d’une élaboration d’un cadre juridique pour faciliter ce travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Nous sommes également en train de former des équipes de terrain. Pour l’instant, il y a que le Cpiad qui avait une équipe de terrain. Le centre Jacques Chirac a également une équipe de terrain qui contacte les usagers.
Nous sommes en train de former aussi des professionnels de santé en matière d’addictologie. Il y a même un diplôme universitaire qui est ouvert par le service de psychiatrie à la faculté de Médecine et qui vise à renforcer les compétences du personnel. Nous menons beaucoup d’activités sur le terrain, des sensibilisations auprès des associations. Nous avons mené également des ateliers de plaidoyers avec les chefs religieux, les chefs coutumiers. L’enjeu est important et constitue une menace pour la santé publique liée aux conséquences à la consommation. L’organisation mondiale de la Santé préconise une approche équilibrée de ces lois. Je pense que dans la riposte par rapport aux problèmes de drogue, il faut la répression, mais il faut aussi une approche santé publique. Chacun doit veiller à faire son travail. Mais il ne faut pas que nos lois poussent les gens à aller vers la clandestinité. C’est dans les pratiques clandestines que se pose la majorité des problèmes. Nous l’avons réussi avec la prostitution, je pense que nous devons faire la même chose avec les consommateurs de drogue. Il faut qu’on les protège, qu’on leur facilite l’accès aux soins.
Les consommateurs de drogues injectables sont très stigmatisés, ce qui rend difficile leur accès aux soins. Qu’est-ce que vous faites pour réduire cette stigmatisation ?
Il y a deux problèmes à ce niveau. D’abord, ce qu’on appelle la stigmatisation, c’est-à-dire le regard que nous portons sur eux. Ensuite, il y a l’auto-stigmatisation. Eux-mêmes s’auto-stigmatisent en disant qu’ils sont mal fagotés, mal habillés et ont peur de venir se soigner. L’addiction est une maladie du cerveau, donc, nous faisons de notre mieux pour les mettre à l’aise. Ce n’est pas de la délinquance. C’est un problème de santé.
La personne qui est dépendante, partout où elle est, que ça soit en prison ou ailleurs, il faut des structures pour leur prise en charge dans notre pays. On est en 2018 et il n’y a qu’un seul centre dédié à cette population. Qu’est-ce qui est proposé à l’usager de drogue qui est à Saint-Louis ou à Matam. Est-ce qu’il est obligé de venir jusqu’à Dakar. Nous avons ouvert une unité de prise en charge à Mbour. Actuellement, il y a une équipe qui travaille à Kaolack pour former les gens à prendre en charge ces aspects. Il faut de la décentralisation. Il faut que cela soit intégré dans leur service de proximité. Les populations utilisent des mots comme drogués, toxicomanes à l’endroit de nos patients. Ce sont des termes péjoratifs qui vont pousser les gens à ne pas révéler leur identité. Nous préconisons le terme ‘’patient’’, parce que nous voyons l’addiction comme étant un problème de santé.
Quels sont les facteurs favorisant la consommation de drogue ?
Il y en a plusieurs. On dit même que l’addiction est une rencontre entre l’individu, le produit et le moment où il le prend. A ce niveau, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Si vous prenez les produits consommés, il y en a plusieurs types. Il y a des produits qui stimulent, d’autres qui apaisent, les uns diminuent l’angoisse, la sensation de fatigue. Il y en a qui perturbent l’activité cérébrale. Chaque produit est caractérisé par son pouvoir addictogène.
Il y a des produits qu’on peut prendre pendant des années sans être dépendant, d’autres, il suffit de les prendre un, deux ou trois fois, pour devenir dépendant. Quand on vit dans un environnement sécurisé, on est protégé par cela. A côté de ces facteurs protecteurs, il y en a qui poussent à la consommation. Cela arrive quand on n’est pas dans un bon état d’équilibre psychologique, quand on ne se sent pas en sécurité, qu’on est déprimé. Donc, il y a des facteurs individuels et des facteurs collectifs. Le moment où on prend la drogue peut aussi influer la disponibilité du produit dans ce lieu. L’environnement, le moment où on le prend, jouent beaucoup sur la première prise. On parle des modèles polyfactoriels qui peuvent pousser la personne à consommer ou pas. On ne peut pas se baser sur une cause pour dire que c’est cela qui fait que la personne a consommé. C’est sur ces trois points (l’individu, le produit et le moment où il le prend) qu’il faut situer le problème.
Quel est le profil des consommateurs de drogues injectables ?
On a un profil très diversifié. L’enquête sur les drogues dures a révélé que ce sont les hommes d’un âge mûr. Mais, depuis qu’on a ouvert le Cpiad, le profil s’est beaucoup plus diversifié. Il y a de plus en plus de jeunes, de femmes. C’est aussi plusieurs catégories sociales. Il y a des gens d’un milieu aisé comme ceux venant d’un milieu précaire. On n’a pas un profil type de consommateurs de drogues.
Quels sont les produits les plus dangereux ?
Ce sont les drogues injectables. C’est surtout par rapport à l’infection du Vih. Elles posent beaucoup plus de problèmes, demandent beaucoup d’investissements et consomment l’essentiel de nos produits et de notre énergie. C’est ce qui nous a le plus poussé à mettre en place le Cpiad. Nous sommes dans un pays à épidémie concentrée concernant le Vih. C’est-à-dire que c’est une épidémie dont la prévalence de la population générale est très basse. Mais chez les populations clés, la prévalence est assez élevée. S’agissant de la population générale, la prévalence est de 0,7%, chez les professionnelles du sexe, elle est à 17% et chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, c’est à 21%. L’enquête que nous avons faite chez les consommateurs de drogue pour les injecteurs, en 2011, la prévalence est de 10%. C’est une population qui est très exposée et c’est ce qui a fait que nous avons tiré la sonnette d’alarme pour dire qu’il faut faire quelque chose pour les aider. Si on ne maîtrise pas l’épidémie au sein d’une population clé, elle peut se propager. Mais il y a également ce droit d’accès aux services de soins de santé. Il faut qu’on donne à ceux qui veulent s’en sortir la chance de se soigner.
Qu’est-ce qui explique ce fort taux de prévalence du Vih chez les injecteurs ?
Il faut voir la situation à plusieurs niveaux. C’est par rapport à la stigmatisation et l’enquête l’a montré. A cause de cette stigmatisation, ils n’avaient pas accès aux messages de prévention. Par exemple, très peu avaient fait un dépistage, très peu savaient que le multi-partenariat peut exposer à l’infection Vih. Très peu savaient utiliser des préservatifs. Il n’y avait aucune mesure de protection, parce que ce sont des gens qui ignoraient beaucoup de choses sur cette maladie. Donc, les messages de prévention véhiculés dans le cadre des programmes n’étaient pas accessibles à cette cible.
La deuxième chose est que du fait de la stigmatisation, ils n’avaient pas accès aux soins ni aux services. L’autre aspect, c’est par rapport aux pratiques. En dehors des pratiques sexuelles, les pratiques de consommation font défaut. Ce sont des gens qui n’avaient pas accès aux matériels stériles. Quand ils s’injectent, c’était une seringue pour tout le monde. Quand on injecte, il n’y a pas que la seringue, mais tout ce qui va avec, l’eau de préparation, ou le tampon qu’on utilise, le coton pour filtrer, etc. Tout cela les exposait et ils n’avaient pas connaissance de ce danger. La première chose qu’on a faite pour cette population, avant les soins, c’est d’abord des messages de prévention sur les Ist et les bonnes pratiques et aussi mettre à la disposition du matériel stérile à usage unique. On a démarré par cela en 2011, en attendant que le centre soit construit.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge de ces patients ?
Les difficultés que nous rencontrons, c’est sur le plan des ressources financières et les ressources humaines. Mais aussi au niveau logistique. Ce centre est unique et tous les patients du Sénégal et ceux de la région de l’Afrique de l’Ouest veulent venir ici. C’est aussi le seul centre spécialisé en Afrique de l’Ouest. Nous sommes débordés. A ce jour, nous avons plus de 1 500 patients. Avec tout ce qu’on a comme problème lié à la construction, c’est difficile. Le personnel aussi est insuffisant. Cela allonge l’attente et rend le travail plus compliqué. Parfois, nous sommes confrontés à une rupture de réactifs. Nous n’avons pas de maalox pour prendre en charge les overdoses et aussi des médicaments pour faciliter le sevrage de certains patients.
Quelle est la part de l’Etat dans ce que vous faites ?
L’essentiel des médecins qui sont là sont des fonctionnaires. Mais le problème, ce n’est pas seulement les médecins, c’est les infirmiers, les travailleurs sociaux, les éducateurs et les médiateurs dont nous avons besoin pour faciliter le travail entre nous et les patients. Nous sommes dans un service public et l’Etat participe aussi au travail. Mais nous avons besoin de plus de moyens pour pouvoir jouer pleinement notre rôle.
Quel est le montant de la prise en charge ?
C’est un problème également. Parce que nous faisons face à une population très précaire, qui la plupart est marginalisée, rejetée. Ils n’ont pas les moyens de se prendre en charge. Ce qui fait que, pour les Cdi, nous avons le programme Vih qui prend en charge les consultations et la méthadone. Pour les bilans, on a des problèmes, parce qu’il n’y a plus de partenaires pour prendre en charge les examens que nous faisons. L’hôpital demande une participation, parce qu’il y a un ticket modérateur de 5000 francs et ils ont du mal à le payer. Le problème reste entier.
VIVIANE DIATTA