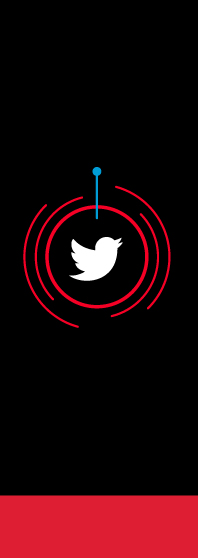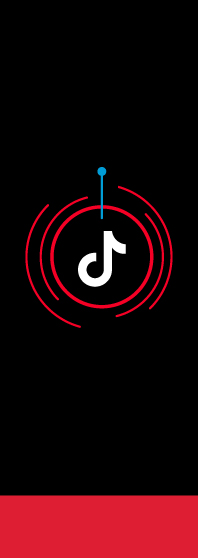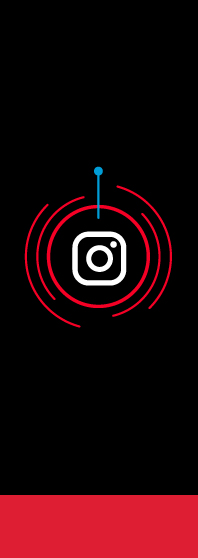Week-end de feu… ou pas ?
Samedi 18 février 2012, il est 15 heures. Pas un chat dans les ruelles délabrées du vieux Dakar-plateau. Et pour cause. La rumeur dit qu’un affrontement imminent, entre les jeunes du M23 et les forces de police, va avoir lieu. L’inquiétude se lit sur tous les visages… reportage.
''Pourquoi ne les laisse-t-on pas manifester tranquillement ?'', s’étonne, non loin de l’avenue Pompidou, une riveraine d’origine cap-verdienne. Personne ne sait… ou plutôt, personne ne peut faire autrement que polémiquer sans fin sur le sujet vu qu’il n’y a pas de réponse réelle et objective à la question. Les discussions s’éternisent entre passants et curieux. Un calme précaire règne, chapotant comme un soupçon d’électricité dans l’air ambiant. C’est ''l’œil du cyclone''. Cette brève période d’accalmie avant la tempête. Et aussi le temps de la seule forme d’espace d’expression non censuré en ce moment : les palabres. Elles vont à tout vent, telle une ''brise''. Et, c’est bien connu, tout le monde a droit au chapitre car les Sénégalais sont experts en tout… Une demi-heure plus tard, les premiers manifestants pointent le bout de leur nez. Ils remontent bruyamment la large avenue vers la Place de l’indépendance, récemment désignée comme le cœur symbolique de leur lutte par l’un de leurs leaders. Jeans ajustés, descendus bas sur leurs hanches, chemises à la mode, sweaters, bonnets, écouteurs vissés sur les oreilles ou pendant au cou… ils ont des dégaines de rappeurs américains. L’attitude aussi. Bras en croix levés au dessus de leurs têtes, ils traitent les policiers debout en face d'eux de tous les noms d’oiseau possibles et imaginables. La riposte ne se fait pas attendre. Elle est si prompte, à vrai dire, qu’on se demande si nos calots bleus ne seraient pas du genre susceptibles, pour perdre le calme si rapidement. C’est le chaos. Tout le monde, manifestants et simples observateurs courent dans tous les sens, se cognant parfois les uns aux autres dans leur hâte d’échapper aux nouvelles lacrymogènes surpuissantes de la police. En ordre dispersé, les gens se tassent dans l’entrebâillement des portes des boutiques, se ruent aux entrées des immeubles, derrière les kiosques à journaux, n’importe où. Ils sont des proies faciles pour la police. Un officier s’avance, fusil en main. Une détonation sourde retentit soudain. Un homme, touché à bout portant, s’écroule au sol. Son sang éclabousse le trottoir. Les policiers se replient précipitamment, alarmés par les cris de la foule en colère. Quelques jets de pierres les accompagnent jusqu’à leur pick-up, mais rien de bien méchant. On ne fait plus trop attention à eux. Les gens sont comme hypnotisés par la vue du sang. C’est un spectacle auquel on est si peu habitué. Personne ne sait comment réagir avant que la sirène stridente de l’ambulance ne se fasse entendre. Le blessé est mis sur une civière, embarqué à bord, évacué vers l’hôpital le plus proche. Tout le monde se regarde. On réalise que non, ce n’est pas un jeu que de manifester pour ses droits civiques dans un état policier. On s’aperçoit également qu’on n’est pas non plus vraiment préparé à se battre. Alors que faire maintenant ? Rien. Les gens ne feront rien. Et les policiers le savent, multipliant les actes violents, les tirs, forçant les manifestants (à présent refroidis) à reculer jusqu’à l’avenue Lamine Guèye voisine. Personne ne les aide, personne ne bouge. Tout le monde parle, parle, parle…Mais que valent des paroles face à des fusils à pompe ? Des balles ? Des lacrymogènes ? Pas grand-chose. Et ça aussi, on le sait. Les heures passent. Les policiers tiennent la rue. Ils éteignent, un à un, les feux d’appoint allumés par les manifestants. Autant de flammes, comme d’espérances, noyées sous les jets du camion dragon des GMI…La nuit tombe doucement. Les badauds désertent les lieux, les curieux aussi. On laisse le soin aux ''jeunes'', à la ''banlieue'' de faire la révolution. Du moment que ce soit quelqu’un d’autre. Personne n’a envie de se faire blesser. On rentre chez soi, donc, on tourne sa clé dans la serrure de la porte d’entrée en se disant qu’on a au moins été là, qu’on a au moins joué un rôle, aussi minime soit-il, dans la lutte.
Sophiane Bengeloun