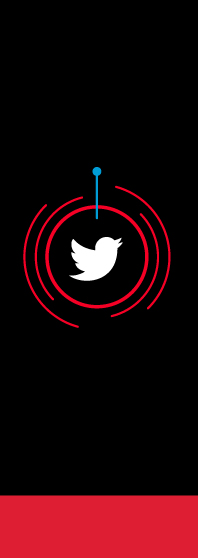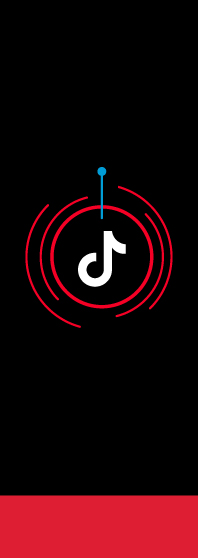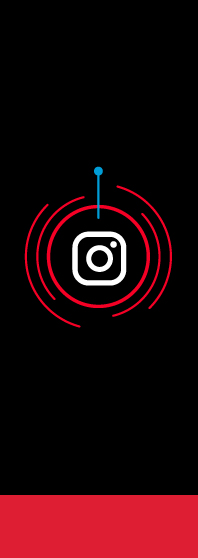En finir avec les planques à billets
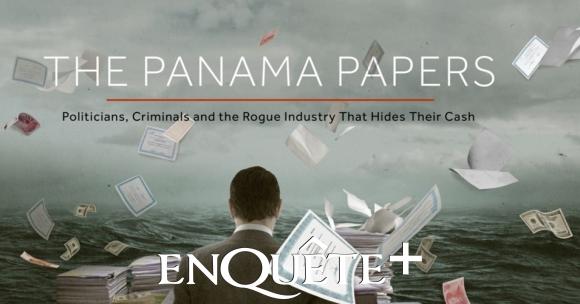
Des dizaines de chefs d’Etat, des centaines d’entreprises, des milliers de contribuables, des milliards qui échappent aux caisses des Etats. Les «Panama Papers», preuve d’une évasion fiscale massive, n’ont pas fini d’alimenter le débat sur les paradis fiscaux.
Février 2016 : le Gafi, organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, retire le Panama de son ultime liste de pays «à haut risque» en lui donnant quitus : «Le Gafi reconnaît que le Panama a fait des efforts dans l’amélioration de son régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.» Deux mois plus tôt, la France, qui possède sa propre liste grise (six pays à ce jour) des paradis fiscaux, envisageait d’y réintégrer le même Panama en raison d’une coopération «insuffisante» en matière fiscale.
Que faire pour mettre définitivement fin au barnum ? A elles seules, l’évasion et la fraude fiscales européennes représentent entre 60 et 80 milliards d’euros de manque à gagner pour l’Etat, soit l’équivalent du déficit budgétaire. En Europe, elles pèseraient 1 000 milliards d’euros. Et la moitié du PIB mondial transiterait par les paradis fiscaux. La fraude en tant que telle est plus difficile à chiffrer, tant la frontière est étroite avec l’optimisation. Elle tient «à l’épaisseur du mur des prisons», selon le mot d’un ancien ministre britannique des Finances. Néanmoins, des solutions existent.
Généraliser les échanges de données fiscales
Un pays A accepte d’ouvrir le capot à un pays B, au cas où un ressortissant du second aurait planqué du fric chez le premier. Selon un savant calcul de l’ONG CCFD-Terre solidaire, si tous les pays du monde acceptaient de se donner la main, cela aboutirait à 29 161 accords croisés de coopération fiscale à travers la planète. Le curseur reste actuellement bloqué à 700. C’est dire l’ampleur du travail restant à accomplir. C’est aussi toute l’impasse de la lutte contre l’évasion fiscale menée à ce jour par divers organismes internationaux (OCDE, G20, Gafi, UE…) visant initialement à établir des listes noires de pays dits «non coopératifs» en matière fiscale. Une politique de name and shame («nommer et couvrir de honte») censée faire rentrer tout le monde dans le rang. Celle de l’OCDE, pionnière en la matière, a ainsi fondu au soleil jusqu’à tendre vers zéro en 2009 : «Il n’y a actuellement plus aucune juridiction dans la liste des paradis fiscaux non coopératifs», proférait alors l’ONG. Sauf qu’il suffisait de conclure douze accords bilatéraux pour en sortir. Les paradis fiscaux ont donc signé entre eux, Monaco topant là avec Andorre, les Samoa ou le Liechtenstein… «Petits arrangements entre amis», dénonce alors en France le Syndicat national unifié des impôts (Snui). Mais les pays développés ne donnent pas toujours le bon exemple. L’Italie préfère ainsi signer un accord de coopération avec… le Groenland plutôt qu’avec son voisin monégasque.
Priver les banques de paradis
C’était la proposition numéro 7 du candidat Hollande en 2012 : «J’interdirai aux banques françaises d’exercer dans les paradis fiscaux.» Bonne idée. Aussitôt enterrée. La BNP possède pas moins de vingt filiales aux îles Caïmans. «Si c’est pour financer le développement local, une seule suffirait», ironise le sénateur communiste Alain Bocquet, auteur d’un pertinent rapport sur l’évasion de capitaux. La promesse hollandaise s’est rapidement muée, en 2013, en simple obligation pour les banques de publier un «reporting pays par pays» de leurs activités à travers le monde. Toujours mieux que rien. D’autant que l’UE adoptera dans la foulée la même mesure. La France à la pointe de la transparence internationale ? Raté. Gueule de bois même, fin 2015, quand les députés envisagent d’étendre la mesure aux multinationales en tout genre. Après avoir adopté le principe à deux reprises, l’Assemblée nationale accepte de manger son chapeau suite à un nouveau vote exigé par le gouvernement, au nom de la «compétitivité des entreprises françaises». Cette fois, il faudrait attendre que l’UE s’y mette en premier avant que la France se mette au diapason. Mais Bruxelles ne semble guère pressé… Sur ce coup-là, la France «a montré un bien triste visage», euphémise CCFD-Terre solidaire.
Faire sauter le «verrou de Bercy»
Au plan strictement franco-français, les poursuites pour fraude fiscale relèvent du monopole de la Direction des impôts. Sauf que les principales prises de ces dernières années ne sont pas forcément le fruit d’un travail de fourmi de ses agents du fisc. Bien plus souvent d’un paquet cadeau amené clés en main par un lanceur d’alertes ou un repenti - des anciens salariés bancaires, quelle que soit leur appellation. Lesquels informent, selon les circonstances ou leurs motivations, la concurrence, le fisc, les médias…«J’ai toujours dit qu’il fallait faire sauter le verrou de Bercy, opaque et antidémocratique, estime l’ancienne magistrate Eva Joly. Les discussions au ministère des Finances sont en fait un marchandage entre des avocats d’affaires et l’administration fiscale.»
En finir avec les prête-noms des sociétés offshores
En 2009, au lendemain de l’explosion de la bulle des subprimes, les dirigeants du G20 promettaient de «refonder le capitalisme». On n’a rien vu, car il suffit de se cacher derrière un prête-nom, le fameux nominee director… Un faux nez faisant office de propriétaire officiel de la coquille offshore.
Mettre fin à cette arnaque légale ? Il suffirait d’interdire tout bonnement l’usage des prête-noms. Des Etats (européens notamment) se disent prêts à le faire en consignant les vrais propriétaires sur des registres nationaux, mais demeurent mous du genou à ce stade : ces vœux pieux restent à transposer dans la législation.
Et même dans ce cas, resterait à rendre publics ces registres des véritables ayants droit offshore. Ce serait la meilleure des dissuasions, mais l’Union européenne traîne des pieds.
Prix de transfert : mettre fin à l’inceste fiscal
Il est ici question des multinationales, ces principaux profiteurs du nomadisme fiscal. Les pouvoirs publics ont enfin réalisé l’importance de déterminer qui paie l’impôt, et surtout où, dans les transactions entre les différentes branches d’une même société. Lorsque plus de 60 % des échanges mondiaux sont le fait de multinationales, l’importance des prix de transfert s’avère cruciale. La manœuvre est relativement simple : siphonner le cash d’une filiale (là où la fiscalité est lourde) et booster le résultat de l’autre (là où elle est clémente). Souvent planquée au Luxembourg, en Irlande, à Andorre. Les Ikea, Google, Facebook, Amazon et autres Microsoft et Twitter en ont fait leur stratégie fiscale par excellence…
La solution ? Il suffirait de contrôler la véracité de ces prix de transferts et de faire en sorte que les Etats se donnent réellement les moyens de ces contrôles. «Pour prendre la moindre décision fiscale, il faut l’unanimité des pays européens. C’est la meilleure manière d’être certain que rien ne sera fait», déplore Chantal Cutajar, spécialiste de l’évasion fiscale.
Imposer un embargo pur et dur
C’est l’arme de dissuasion ultime pour convaincre les paradis fiscaux récalcitrants : le blocus total, financier et commercial. Le seul langage que peuvent comprendre les Etats croupions récalcitrants ?
En juillet 2015, l’Union européenne ayant inscrit le Panama sur sa nouvelle liste noire des pays non coopératifs, ultime et vaine tentative de name and shame, le président panaméen, Juan Carlos Varela, répliquait sur un ton martial : «Nous n’allons pas permettre que l’on nous porte préjudice.» Et le chef de l’Etat de menacer d’interdire toute entreprise européenne de se porter candidate à un marché public local, que le hiérarque évalue à 20 milliards de dollars sur cinq ans. (Liberation.fr)
Qui se cache derrière le cabinet Mossack Fonseca ?
Le cabinet spécialiste des sociétés offshore assure sur son site pouvoir "protéger les actifs de diverses menaces". Mais pas des lanceurs d'alerte.
"C'est un crime, un délit", a déclaré Ramon Fonseca Mora, directeur et cofondateur de Mossack Fonseca, après la divulgation de documents regroupés sous la dénomination « Panama Papers » et provenant des archives de ce cabinet d'avocats panaméen, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore. C'est la plus grosse fuite d'informations jamais exploitée par des médias : d'après Le Monde, qui révèle en France l'information, il s'agit de « plus de 214 000 entités offshore créées ou administrées par le cabinet d'avocat panaméen depuis sa fondation en 1977 et jusqu'en 2015, dans 21 paradis fiscaux différents et pour des clients issus de plus de 200 pays et territoires ». Plus de cent journaux ont réalisé cette enquête sur des avoirs détenus dans des paradis fiscaux par des personnalités de premier plan.
Ramon Fonseca Mora, né en 1952, a obtenu un diplôme de droit à Panama mais a poursuivi ses études à la prestigieuse London School of Economics. Dans une interview, il avait indiqué avoir envisagé de devenir prêtre. Juergen Mossack, l'autre fondateur du cabinet d'avocats, est né en Allemagne en 1948, avant d'émigrer au Panama avec sa famille où il a fait ses études de droit. Son père était un nazi qui avait servi dans les SS (unités d'élite de l'armée allemande) pendant la Seconde Guerre mondiale, selon l'ICIJ qui cite des documents de l'armée américaine. D'après « d'anciens dossiers des renseignements », il a proposé d'espionner pour le compte de la CIA.
« Protéger les actifs »
Ramon Fonseca Mora dirigeait une petite société avant la fusion avec Juergen Mossack. Les deux avocats ont d'abord ouvert un bureau aux îles Vierges britanniques. Selon l'ICIJ, la moitié des sociétés que le cabinet a créées – plus de 113 000 – étaient basées dans ce paradis fiscal. Mais Mossack Fonseca a également ouvert une branche dans un micro-État du Pacifique, Niue. En 2001, les revenus de la firme étaient si élevés dans cette île qu'ils contribuaient à 80 % du budget annuel de Niue. Lorsque, sous la pression internationale, les îles Vierges britanniques ont été contraintes d'abandonner le système des actions au porteur anonymes, Mossack Fonseca est revenu au Panama et s'est également installé dans l'archipel d'Anguilla, dans les Caraïbes.
La firme a dépensé de l'argent pour tenter d'effacer les références sur internet la liant à des pratiques d'évasion fiscale et de blanchiment. Mais plusieurs pays ont commencé à suivre ses activités de près. Au Brésil, elle a été citée dans le cadre du scandale de corruption du géant pétrolier étatique Petrobras, qui secoue le pays. Aux États-Unis, un juge du Nevada a estimé que le cabinet avait tenté volontairement de masquer son rôle de gestion dans sa branche locale dans cet État américain. Le mois dernier, Ramon Fonseca Mora – qui a été un conseiller du président panaméen Juan Carlos Varela depuis 2014 – a annoncé qu'il prenait un congé. Il a expliqué avoir pris cette décision « pour défendre (son) honneur », alors que les accusations dans le dossier brésilien se multipliaient.
Sur le site internet du cabinet Mossack Foseca, disponible en anglais, espagnol en en chinois, le cabinet d'avocats assure pouvoir « protéger les actifs de diverses menaces, y compris les troubles politiques, les héritiers téméraires et plus encore ». Mais pas des lanceurs d'alerte !
(le point.fr)