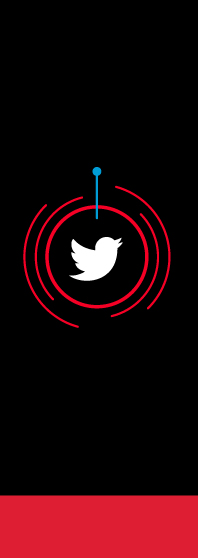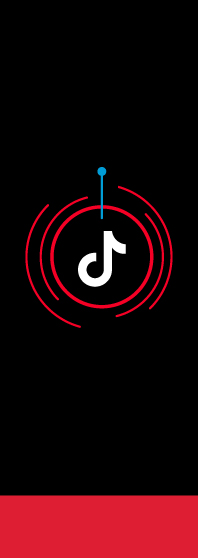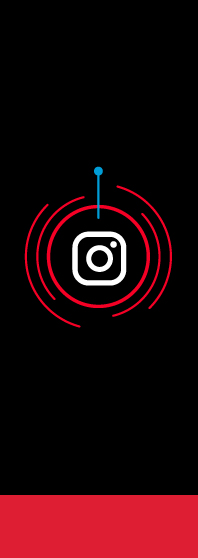Bettenty, les ondes d’un choc

L’ilot de tranquillité assimilable à un coin paradisiaque, un grand reposoir, est sorti de l’anonymat de la pire des manières : 21 victimes féminines dans un naufrage. C’est toujours l’incompréhension la plus totale pour les résidents en deuil collectif.
On est encore groggy du coup de lundi dernier. Bettenty est comme sous anesthésie locale. La mort d’une femme est toujours un drame en milieu Socé. La disparition simultanée de 21 d’entre elles est une tragédie. 24 heures après leur enterrement au cimetière du quartier de Sibito, c’est la foire aux condoléances dans cette île baignée par le Delta du fleuve Saloum. Les pleurs de la veille ont cédé la place à un silence de mort qui n’a rien à voir avec la quiétude habituelle des lieux. Par petits groupes d’hommes et de femmes, les délégations venues des îles voisines de Bassoul, Niodior, Dionewar, Djinda, Silo, Moundé, Bassar, Diogane, Faliya investissent les maisons une à une pour en ressortir après une dizaine de minutes, des paroles de réconfort pour consoler les familles de victimes.
Dans la famille Marone établie au quartier Madina, l’imam Sira Kata a perdu cinq membres de sa concession. Posture résignée et froide, Djellaba verte, chapelet défilant entre ses mains, il rabat une écharpe blanche qui tombe sans cesse, en relatant difficilement les faits au point que son grand frère Djibril, le précédent imam, vole à son secours. ‘‘Nous n’avons que nos yeux pour pleurer, mais nous nous en remettons à Dieu’’, déclare-t-il. Dans la pénombre du salon transpercé par quelques rais venus du plafond en zinc, une sucession de présentations de condoléances par intervalles réguliers. Par des tapes amicales et des messages d’encouragement, tantôt prodigués en Socé, la langue majoritaire, tantôt en Sérère niominka, la langue autochtone, les visiteurs tentent d’apporter du baume au cœur du maître des lieux. Dans la grande maison mêlant construction en dur et chaumières en paille, les Dieynaba Marone, Khady Dramé, Hawa Seydi, Fatou Sarr et la très proche Safyatou Ndour ne verront plus le jour. Pour un proche parent de la famille, Abdaty Diouf, très remonté contre cette insouciance qui a conduit à la mort de ces femmes, il faut situer les responsabilités.
17 morts en 1994
Après les drames dont a été victime Alaji Yaya Binta Sarr en 1987, l’hécatombe de 1994 ou 17 personnes avaient perdu la vie, la tragédie de lundi dernier est un amer constat pour ce pêcheur maintenant établi en Casamance, qui a toujours tiré la sonnette d’alarme. ‘‘C’est la faute au capitaine ; il n’avait qu’à refuser de faire démarrer la machine comme certains le font.’’
La nuit précédente, mardi à mercredi, les rotations se sont exceptionnellement poursuivies au quai de Missirah pour permettre aux parents éplorés de se rendre à Bettenti suivant les directives du maire de Toubacouta, Pape Seckou Dianko. Une traversée nocturne de deux heures de temps qui a trouvé toute la communauté endeuillée endormie. Hier, Bettenty avait l’air de ne toujours pas vouloir se réveiller de ce cauchemar. Sur le rivage, la pirogue blanche du drame immatriculée FK 2148 MS, dimensions modestes, vogue tranquillement au gré des flots d’un fleuve encalminé. Rien d’indiciel sur les événements tragiques à part une marmite perdue entre les traverses de bois ainsi que des tiges métalliques utilisées par les femmes pour la pêche aux fruits de mer. A ses côtés, plusieurs autres petites embarcations prises d’assaut par des enfants dont la gaieté innocente et exhibée contraste avec le deuil.
‘’La surcharge était évidente. On a demandé au capitaine de faire demi-tour…’’
Combien étaient-elles dans la pirogue en dehors du capitaine, Yaya Seydi et de ses quatre ‘‘matelots’’ de fils ? 80 comme l’affirment les plus péremptoires ou 55 pour les minimalistes ? Les chiffres officiels de 21 morts et 51 blessés confirment que 72 personnes étaient dans la barque comme l’affirme une rescapée du reste. ‘‘Nous étions plus d’une soixantaine’’, confirme Saly Diouf. Emmitouflée dans une grande burqa noire dans laquelle elle se recroqueville à chaque question, elle se remémore les événements tragiques, affalée sur un matelas, sous les encouragements de Tamara Sarr, une autre rescapée, de son mari, et de son frère qui traduisent à qui mieux mieux ses témoignages saccadés. ‘‘On avait profité de la marée basse pour aller chercher des fruits de mer vers 11 heures comme à l’accoutumée. A seize heures passées, la marée a commencé à monter. Le capitaine nous a demandé de nous préparer à rentrer. Quand nous sommes toutes montées en plus de nos seaux, la surcharge était évidente. On a demandé à Yaya de faire demi-tour pour laisser quelques-unes d’entre nous à quai et de venir nous récupérer plus tard’’, témoigne-t-elle, se blottissant davantage contre le mur bleu décrépi de sa chambre. Une entente commune contre laquelle s’est dressée une vague scélérate qui a envoyé la pirogue au fond malgré les manœuvres du capitaine, d’après elle. Les pêcheurs Sérères qui ne les ont plus revues se sont dit qu’il y a problème. Ce sont eux qui sont venus porter les premiers secours avant de téléphoner pour sonner l’alerte. ‘‘A ce moment, c’était chacun pour soi. Certaines ont appelé au secours de toutes leurs forces, mais l’instinct de survie a pris le dessus. Je me suis agrippée à tribord de la pirogue. Certaines ont attrapé mon voile et je m’en suis départie. D’autres m’ont prise par la burqa, je la leur ai laissée. C’est à cause de la panique que beaucoup d’entre nous ont péri’’, poursuit-elle, attendant près d’une heure avant que les pêcheurs qui mouillaient pas loin ne viennent leur porter secours. Piètre nageuse, de son propre aveu, elle affirme à demi-mots que la pirogue était trop petite pour le chargement. Au domicile du capitaine Seydi, un alignement de seaux qui ont perdu leurs propriétaires témoigne de l’ampleur du drame. Encore sous observation médicale, c’est son jeune fils, entouré de ses deux frères, tous adolescents, qui donne leur version de l’histoire. ‘‘Mon père leur a demandé (à certaines) de ne pas embarquer, mais elles n’ont rien voulu entendre’’, confie-t-il.
C’est la faute aux hommes
Derrière l’image d’Epinal de cette île de rêve, aux rivages bordés par de grands palmiers, où les animaux végètent sous les claies de séchage, où les amas de coquillage parsèment le décor, se cache une réalité bien connue de la majorité des Sénégalais : la pauvreté. Cerné d’eau de toutes parts, les potentiels de Bettenty sont tellement limités. Les deux activités pour avoir des revenus qui s’offrent aux résidents sont la pêche pour les hommes et le ramassage des moules ou huîtres pour les femmes. Dans les grandes concessions, on se hasarde quelquefois au maraîchage, tandis que l’élevage, même à domicile, semble relever de l’exception.
Les maisons portent les marques de l’eau puisque les briques sont moulées avec des coquillages. Plusieurs couches étant frappées par cette paupérisation, les femmes portent le poids d’une économie familiale face à ce qu’elles considèrent comme une démission maritale. ‘‘C’est la faute aux hommes. Ils refusent d’assumer leurs responsabilités de maris et de pères. Ce qui les intéresse, c’est de faire des enfants ou dans le cas contraire, aller vous dénoncer une fois entre eux sur la place publique. Ils ne nous servent à rien’’, s’offusque Marie Sarr, femme d’un pêcheur qui, selon elle, n’en fait qu’à sa tête. Résultats pour cette île perdue de plus de dix mille âmes ? Les femmes sont obligées de participer à la seule forme d’épargne qui leur préserve un semblant de dignité, appelée ‘‘Nàtt’’ (Ndlr : Tontine). Selon un enseignant s’exprimant sous le sceau de l’anonymat, cette formule qui les oblige à cotiser 10 000 ou 15 000 F CFA tous les dix jours est excellente sur le principe mais à revoir dans la pratique. ‘‘Cette pression monétaire les pousse à être en permanence sur le qui-vive, non seulement pour la survie de la famille mais aussi pour respecter la cotisation’’, explique-t-il.
Le business des moules est assez rentable puisqu’avec deux pots de beurre, (l’équivalent d’un kilogramme), ces femmes parviennent à se faire 750 F CFA. ‘‘D’habitude, quand elles vont en chercher, c’est pour en ramener le maximum possible. Les moules sont lourdes en ce moment puisqu’elles renferment de l’eau. Les prises sont des fois revendues à Dakar à 2500 F CFA le kilo’’, confie un pêcheur du nom de Sarr.
|
MAI SENE ENCEINTE ET RESCAPEE ‘‘Je retournerai chercher des moules’’ On a toujours le choix, a-t-on l’habitude d’entendre. Après avoir échappé à la noyade, Maïmouna Sène promet de se jeter à l’eau de nouveau...par manque de choix justement. Que diable allait chercher une femme enceinte dans cette galère ? Maïmouna dite Maï Sène est d’un fatalisme consternant en répondant à cette question. ‘‘Tu sais très bien que je n’ai absolument rien pour nourrir ma famille’’, lance-t-elle en s’adressant à son homonyme, Maïmouna Djiba, qui traduisait ses propos tenus en Socé en Wolof. Regard presque intimidant accouardi par des larmes, la rescapée de 31 ans est dans un ensemble qui cache une grossesse qu’on a du mal à deviner. Caressant sa gorge endolorie par la violence des événements, elle n’est pas au bout de ses peines. Dans sa chaumière dont l’appellation du quartier, ‘’Tranquille’’, est un pied de nez aux événements actuels, elle est entourée de quatre de ses cinq enfants, dont le petit dernier qui vient à peine de boucler un an. La jeune femme témoigne avec beaucoup de résignation, d’une voix presque éteinte : ‘‘Les cris de mes consœurs appelant à l’aide résonnent toujours dans ma tête. Depuis le jour du drame, je n’arrive plus à dormir’’, fait-elle savoir. Une grossesse contractée il y a six semaines ne l’a pas empêchée d’aller mouiller pour récupérer les aches (pagne), une activité qui l’occupe depuis 16 ans qu’elle a quitté la Gambie. Sans les vicissitudes de la vie, elle aurait pu être une dame distinguée puisqu’elle a fini son second cycle chez Barrow. Mais le destin en a décidé autrement. Comme celle miraculeuse de la laisser en vie alors qu’une femme dans son cas a été emportée par la fatigue après avoir été sauvée des eaux. Pour son cas, la providence s’est manifestée sous la forme d’une vague. ‘‘Je perdais pied et remontais. Je commençais à manquer de souffle quand un vague m’a poussée vers la pirogue et je m’y suis agrippée. Certaines, dans leur affolement, m’ont prise par la gorge d’autres par la main. Mais je me suis débattue’’, renseigne-t-elle. Revenue de Sokone avant-hier mardi où elle a été consultée, sa grossesse ne souffre d’aucune complication d’après l’échographie qui lui a été faite. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, Maï attend juste que l’affaire se tasse pour renouer avec son vieil amour qui a failli lui être fatal. La foi en bandoulière et le fatalisme de rigueur, elle déclare : ‘‘Je rends grâce à Dieu, mais bien sûr que je vais retourner chercher des moules. Je n’ai pas d’autres choix pour faire vivre ma famille.’’ Le capitaine Seydi est rentré Il gesticule, marmonne, souffre dans son corps. Les mains portant les stigmates des perfusions qu’il vient de subir, Yaya Seydi, le capitaine de la pirogue, tente à grands renforts gestuels d’expliquer ce qui s’est passé. Dans sa chambre, filles, fils, neveux, femmes qui ont préalablement suspecté quelque traitement journalistique désavantageux contre leur ‘’patriarche’’, se sont finalement résolus à nous laisser entrer (Ndlr : en compagnie de confrères de Dakaractu). Rentré hier à 14 heures passées, ‘‘il souffre de douleurs au cou car toutes celles qui se noyaient voulaient s’agripper à lui’’, interprète l’un de ses neveux. Manifestement touché par cette noyade collective, ses proches affirment qu’il souffre énormément dans son esprit et sa chair mais ne confirment ni n’infirment les rumeurs de suicide que la rumeur prête à leur parent. |