Soifs de changement ? Pas la Révolution verte de l’AGRA !
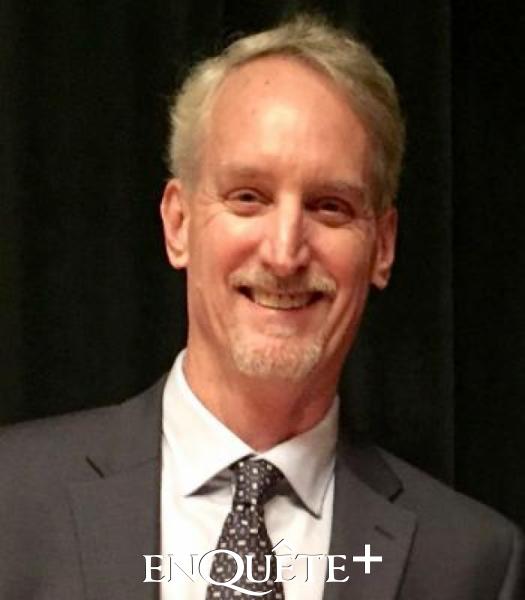
L'AGRA avait promis de réduire de moitié la faim, mais près de deux décennies plus tard et des milliards de dollars, l'Afrique souffre plus que jamais de la faim.
Lorsque les bailleurs de fonds internationaux se joindront aux dirigeants africains et aux chefs d'entreprise pour le Forum annuel sur les systèmes alimentaires en Afrique, qui se tient à Dakar, au Sénégal, du 31 août au 5 septembre 2025, on espère qu'ils feront preuve d'ouverture d'esprit.
Leur hôte, l'AGRA (Alliance pour une révolution verte en Afrique, qui a supprimé le terme « révolution verte » de son nom), a échoué de manière spectaculaire à tenir sa promesse d'une « révolution de la productivité » qui réduirait de moitié la faim. Elle a besoin de nouvelles idées.
Pendant ce temps, ses hôtes sénégalais, qui n'ont rejoint l'alliance que récemment et n'ont jusqu'à présent pas adopté les politiques uniformes de l'AGRA, ont en fait réduit de moitié la faim sévère au cours des deux dernières décennies. Selon les dernières estimations mondiales de la faim publiées par les Nations unies, depuis 2004, le Sénégal a réduit le nombre de personnes souffrant de « malnutrition chronique » à seulement 5 % de sa population.
Dans le même temps, l'Afrique subsaharienne dans son ensemble a vu le nombre de ses habitants souffrant de la faim augmenter de 66 % depuis le lancement de l'AGRA en 2006, ajoutant 100 millions de personnes à la liste des affamés en Afrique. Les principaux pays membres de l'AGRA n'ont pas obtenu de meilleurs résultats.
À la veille du Forum sur les systèmes alimentaires de l'AGRA, les délégués devraient reconsidérer les prémisses erronées des politiques de révolution verte de l'AGRA, qui ont échoué.
Ils devraient plutôt s'inspirer de pays comme le Brésil, qui a considérablement réduit la faim au cours des dernières années.
L'approche défaillante de l'AGRA
L’ « intensification durable » est un terme savant qui désigne le concept simple consistant à produire plus de nourriture sur la même superficie, sans nuire à l'environnement. Selon cet argument, à mesure que la population augmente et que les terres agricoles se raréfient, nous devrons intensifier la culture des terres agricoles existantes pour nourrir ces populations. L'alternative, qui consiste à étendre la production à de nouvelles terres (l'extensification), implique toute une série de coûts environnementaux, allant des émissions climatiques à la déforestation en passant par l'érosion des sols.
La formule de la révolution verte pour parvenir à une intensification durable passe par l'introduction et la diffusion de semences commerciales à haut rendement et des engrais et pesticides synthétiques qui permettront de les produire.
L'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) a été fondée en 2006 par les fondations Gates et Rockefeller dans ce but précis. Elle a investi plus d'un milliard de dollars pour, selon ses propres termes, doubler la productivité et les revenus de 30 millions de familles d'agriculteurs tout en réduisant de moitié l'insécurité alimentaire. Les gouvernements africains de la plupart des 13 pays cibles de l'AGRA ont collectivement versé environ un milliard de dollars par an en subventions aux agriculteurs pour l'achat de ces semences commerciales, d'engrais et d'autres intrants de la révolution verte.
Comme le suggèrent les chiffres de la faim publiés par l'ONU, les résultats de l'AGRA en matière de catalyse de sa « révolution de la productivité » sont désastreux. Comme je l'ai montré dans une évaluation historique de l'AGRA réalisée en 2020, les rendements ont à peine augmenté, même pour les cultures fortement subventionnées comme le maïs. Dans tous les pays de l'AGRA, les rendements du maïs n'ont pas doublé ; ils n'ont augmenté que de 29 % en 12 ans. Il s'agit d'une croissance de la productivité lente selon tous les indicateurs de développement, et elle est extrêmement faible compte tenu des milliards de dollars de subventions et d'aide accordés à une culture prioritaire.
Si l'intensification a été un échec, la durabilité a connu un sort encore pire. Toutes les mesures incitatives en faveur de certaines cultures telles que le maïs et le riz ont encouragé la monoculture, année après année, sur les mêmes terres. Ce type d'intensification, sans rotation des cultures et alimenté par des quantités croissantes d'engrais synthétiques, a appauvri les sols, compromettant leur fertilité à long terme.
Pire encore, les subventions et autres aides accordées à la monoculture du maïs ont nui à la diversité des cultures existantes. Avant l'AGRA, le millet était une céréale de base beaucoup plus courante. Il est plus nutritif et plus résistant au climat que le maïs. Douze ans après le lancement de l'AGRA et de sa promotion obsessionnelle du maïs, la production de millet avait chuté de 24 % et les rendements avaient baissé de 21 %. D'autres denrées alimentaires de base traditionnelles telles que les arachides et le manioc ont également vu leurs rendements diminuer sous la surveillance de l'AGRA. Les rendements du sorgho ont également stagné.
Non seulement l'AGRA n'a pas aidé les agriculteurs à produire davantage de maïs pour la consommation familiale, mais elle a réduit la diversité nutritionnelle de l'alimentation des ménages en compromettant la diversité des cultures. Il n'est donc pas étonnant que les indicateurs de la faim de l'ONU soient si mauvais.
Qu'ont produit toutes ces subventions de la révolution verte ? L'expansion de la production agricole sur de nouvelles terres, exactement le type d'extensification que l'AGRA cherchait à éviter. Toutes ces subventions ont encouragé les agriculteurs à cultiver du maïs sur 45 % de terres supplémentaires. Au total, les subventions de la révolution verte au maïs et au riz ont entraîné une augmentation de 11 millions d'hectares de terres agricoles consacrées à ces deux cultures dans les pays de l'AGRA. Avant l'AGRA, le millet et le sorgho étaient des céréales de base beaucoup plus importantes. En 2018, le maïs et le riz couvraient autant de terres que ces deux céréales traditionnelles.
Après plusieurs années de protestations de la part des agriculteurs africains et des groupes de la société civile, les bailleurs de fonds de l'AGRA ont commandé une évaluation du programme en 2022. Celle-ci a confirmé que le programme n'avait pas atteint ses objectifs en matière de productivité, de revenus ou de sécurité alimentaire. Peu importe. La Fondation Gates a promis 200 millions de dollars supplémentaires pour un plan quinquennal qui ne fait pas grand-chose pour remédier aux échecs de sa révolution verte.
Comme on pouvait s'y attendre, le seul changement notable a été cosmétique : l'AGRA a discrètement annoncé qu'elle changeait de nom et qu'elle serait désormais connue uniquement par son acronyme, et non plus sous le nom d'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Elle a peut-être supprimé les mots « révolution verte », mais rien n'indique qu'elle ait accédé à la demande des agriculteurs africains d'investir plutôt dans l'agroécologie et d'autres stratégies à faible intensité d'intrants et centrées sur les agriculteurs. Désormais, AGRA ne signifie littéralement plus rien.
Un autre monde est possible.
Les dirigeants sénégalais pourraient peut-être montrer une autre voie aux délégués du forum et aux bailleurs de fonds. Le Sénégal est en effet un pionnier dans la promotion d'une agriculture écologique à faibles intrants. Avec une stratégie nationale d'agroécologie en cours et les premières mesures visant à subventionner les intrants biologiques, le Sénégal montre la voie à suivre pour réduire la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires et des intrants. La société civile ouest-africaine appelle les dirigeants, à commencer par le Sénégal, à reconnaître les semences paysannes comme le pilier de la souveraineté alimentaire, à investir dans les banques de semences communautaires, à réorienter les subventions aux engrais et à développer la production de biofertilisants, afin de faire de la santé des sols le fondement d'un avenir africain résilient.
Dans le même temps, les dirigeants peuvent s'inspirer du Brésil. En quelques années seulement, le Brésil a pratiquement éliminé la faim extrême. Depuis 2023, la nouvelle campagne « Brésil sans faim » du gouvernement du Parti des travailleurs a réduit ce pourcentage à moins de 2,5 % tout en sortant 40 millions de Brésiliens de l'insécurité alimentaire modérée ou grave. Comme le dit le groupe de recherche international IPES-Food, cette campagne a impliqué une trentaine de mesures ministérielles qui ont fonctionné « non pas grâce à des solutions technologiques ou à l'augmentation des rendements, mais grâce à des politiques axées sur les personnes afin de garantir l'accès à la nourriture ».
Comme l'a souligné Raj Patel, expert de l'IPES-Food, « mettre fin à la faim n'est pas un casse-tête technologique. Ce qui fonctionne, c'est de soutenir les agriculteurs familiaux plutôt que l'agro-industrie, d'investir dans les repas scolaires, les programmes publics et l'accès à la nourriture. Ce ne sont pas des idéaux utopiques, ce sont des outils qui ont fait leurs preuves. La seule question est de savoir si d'autres gouvernements agiront avec le même courage ».
Mariama Sonko, présidente du mouvement international des femmes agricultrices We are the Solution, a résumé l'appel à l'action : « L'avenir de l'Afrique dépend de nos semences, de nos sols et de nos exploitations familiales. La promotion de l'agriculture écologique crée plus d'emplois et de richesse pour les économies rurales, tout en protégeant et en améliorant nos paysages. J'exhorte les délégués du Forum sur les systèmes alimentaires à soutenir la transition vers l'agroécologie, car seule l'agroécologie peut garantir une véritable souveraineté alimentaire à nos populations. »
Timothy A. Wise
Timothy A. Wise est chercheur senior au Global Development and Environment Institute de l'université Tufts aux États-Unis. Il est l'auteur du livre Eating Tomorrow: Agribusiness, Family Farmers and the Battle for the Future of Food (Manger demain : l'agro-industrie, les agriculteurs familiaux et la bataille pour l'avenir de l'alimentation).
























