«Le ratio un garde pénitentiaire pour huit détenus n’est pas acceptable»
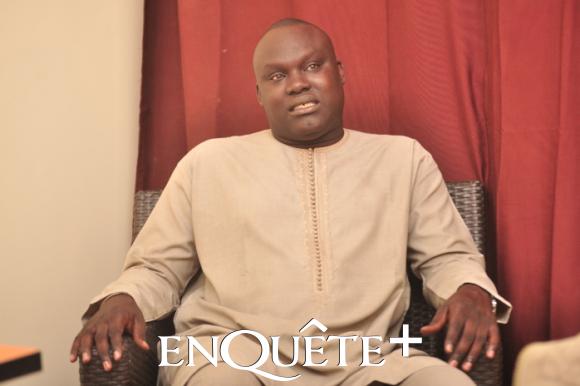
Le président du Comité sénégalais des droits de l’Homme (CSDL) plaide pour une humanisation de la vie carcérale. La semaine dernière, en marge de la présentation du Plan stratégie 2016-2018 de l'Observateur national des lieux de privation de liberté tenue à Dakar, Me Pape Sène a déploré les conditions de détention dans les prisons sénégalaises, avant d’inviter l’Etat à appliquer les conventions internationales qu’il a ratifiées. Ceci, au grand bonheur des détenus. Dans cet entretien, le militant des droits de l’Homme dévoile son agenda à la tête du CSDL, exprime son souhait d’avoir un budget annuel plus conséquent que les 50 millions de F Cfa dont il dispose, etc.
Quel est l’état des lieux concernant les prisons au Sénégal?
Vous savez, pour répondre à cette question, il faut l’aborder sous plusieurs angles. La plupart de nos prisons sont acquises à l’époque coloniale. Et ça pose la question de la vétusté de ces infrastructures qui doivent accueillir aussi bien les détenus que les personnes condamnées. Alors, si on fait le diagnostic pour en tirer un bilan, on va relever le problème relatif au surpeuplement de nos prisons. C’est une réalité qui est là. Par exemple, la capacité d’accueil de Rebeuss est largement dépassée. Maintenant, sur le plan des conditions de vie, des efforts sont en train d’être faits. Malgré tout, on peut les améliorer. On a la ration journalière des détenus qui passe de 400 à 1000 F Cfa. A mon avis, c’est un pas important. Aussi, l’Etat du Sénégal a engagé une politique d’augmentation de façon sensible de l’enveloppe accordée à la direction de l’administration pénitentiaire pour la prise en charge des détenus. Presque, elle représente la moitié du budget du ministère de la Justice, parce que la vie humaine n’a pas de prix.
Le Sénégal a ratifié des conventions internationales, dans le cadre des droits humains. Mais, leur application tarde, au grand dam des détenus.
J’ai déjà fait allusion au règlement numéro 5 de l’Uemoa sur la profession d’avocat. Il a été pris au niveau de cet espace dont le Sénégal est membre. De façon claire, relativement aux questions de garde à vue, il stipule que dès qu’une personne est interpellée, elle peut se faire assister par un avocat. C’est un règlement. Donc, il est d’application immédiate. Malheureusement, le Sénégal tarde à l’appliquer. De ce point de vue, nous devons faire le plaidoyer nécessaire pour que cette norme internationale puisse avoir une application effective.
En 1999, il y a eu une réforme du code de procédure pénal au Sénégal. Elle permettait, après la prolongation de la garde à vue de 48 heures, que la personne mise en cause puisse être assistée d’un avocat. Mais, malheureusement, ce texte n’était pas accompagné de dispositions pratiques pour que sa mise en œuvre soit effective. Aujourd’hui, nous sommes rassurés par le projet de réforme dans le circuit administratif. Il va se poursuivre de façon très rapide pour que le Sénégal soit en phase avec ce principe de l’Uemoa qui permet de garantir un certain nombre de droits des personnes interpellées dans les commissariats et les brigades de Gendarmerie.
Souvent, on fait état de manque de ressources humaines dans les prisons. Vous, en tant que militant des droits de l’Homme, quel commentaire faites-vous de cette situation?
Effectivement, le manque de ressources humaines pose un certain nombre de problèmes dans les lieux de détention. Et vous savez, le ratio : un garde pénitentiaire pour huit détenus n’est pas acceptable. Donc, il va falloir, dans le sens d’un recrutement massif, mais également de la formation, renforcer le personnel. C’est un aspect important parce que le travail dans l’administration pénitentiaire est extrêmement dur.
Justement, dans son intervention, un agent pénitentiaire a souligné qu’il joue une double fonction: il est à la fois pénitentiaire et assistant social…
Eh bien, ça pose problème. La prison est un milieu de resocialisation. Donc, il est impératif d’avoir un personnel très qualifié pour bien prendre en charge la question du détenu. Et, au-delà de la sanction infligée à la personne, la prison doit servir également de lieu de correction, de transformation de la personne, de formation…pour qu’au sortir de ce milieu carcéral, elle puisse valablement retrouver sa place dans la société.
Quelle analyse faites-vous des longues détentions?
C’est une situation que nous déplorons. Parce que nous pensons que le droit de recevoir un jugement rapide et efficace est un droit universel. D’ailleurs, il est mentionné dans la Constitution du Sénégal, de même que dans les normes internationales ratifiées par notre pays. A cet égard, il n’y a pas de raison, aujourd’hui, qu’on n’aille pas vers cela. Aussi, il faut saluer la réforme entreprise par le Sénégal avec la nouvelle carte judicaire. Présentement, il y a une suppression des cours d’Assise. En lieu et place, on a des chambres criminelles dans les 14 régions du pays où on a des audiences criminelles. Contrairement, aux chambres d’Assise qui étaient très espacées, elles se tiennent régulièrement. Cette approche permet de désengorger les prisons. Il va falloir aussi imaginer des stratégies alternatives comme la médiation pénale dans le but de limiter les condamnations qui envoient les gens en prison.
Comment expliquez-vous les causes de ces longues détentions?
Les causes sont diverses. Parfois, elles peuvent être liées à la nature de la procédure. En matière criminelle, la détention est, selon les textes, illimitée. Par contre, en matière délictuelle, la détention provisoire est limitée à 6 mois pour un certain nombre de délits. Et il n’y a pas de possibilité de renouvellement. Avec l’article 127 bis du code de procédure pénal, dès que le délai de 6 mois expire, et que l’instruction n’est pas clôturée, à partir de ce moment, la personne placée sous mandat de dépôt, de façon provisoire, doit être libérée d’office par la maison d’arrêt. Cette disposition est salutaire, parce qu’elle permet de limiter le temps de la détention. L’autre cause est liée au déficit de personnel de la Justice au niveau de la magistrature, du greffe, du barreau, etc. Et, souvent, le recrutement n’est pas facile, parce qu’il faut des moyens, de la qualité. Heureusement que le concours d’avocats est régulièrement organisé pour permettre un maillage du territoire dans le but d’accompagner les justiciables.
Avez-vous, dans le cadre de vos travaux, identifié des malades mentaux incarcérés en prison?
En tant que praticiens du droit, il y a des concepts que nous ne connaissons pas. Par exemple : malade mental. Parce contre, nous, nous parlons de démence. C’est un élément de fait laissé à l’appréciation du juge. Effectivement, en tant qu’avocat, il m’est arrivé d’être en face d’une personne atteinte de démence, et qui était attraite. Mais, à chaque fois que le juge, après analyse des faits, se rend compte que nous sommes en présence d’une personne atteinte de démence, il en tire toujours les conséquences de droit. C’est donc une irresponsabilité pénale qui est prononcée. Et nos juridictions appliquent cette disposition de la façon la plus souveraine possible. Donc, il n’y a pas de problèmes particuliers à ce niveau.
Après les longues détentions, une indemnisation est prévue pour le détenu. A votre avis, ce principe est-il appliqué au Sénégal?
En matière criminelle, quand vous faites l’objet d’une longue détention, à l’issue de laquelle vous êtes acquitté, vous avez la possibilité d’engager une procédure pour une indemnisation. Mais, malheureusement, aujourd’hui, peu de personnes utilisent cette disposition légale. C’est donc le moment de le dire pour que nul n’en ignore. L’Etat a mis en place cette disposition pour permettre à ces personnes de demander valablement réparation.
Comparé aux autres pays en Afrique de l’Ouest, comment se présente le Sénégal par rapport au respect des droits humains?
En toute honnêteté, nous avons des raisons de nous glorifier. Contrairement à beaucoup de pays, aussi bien en Afrique que dans le monde, nous ne sommes pas au banc des accusés. Et je rappelle que le combat pour la protection des droits de l’Homme est toujours une nécessité. Ainsi, pour mesurer la situation réelle ou le niveau d’évolution des droits de l’Homme dans un pays, il va falloir, forcément, faire la lecture du niveau de démocratie, de l’Etat de droit, du pays concerné. Actuellement, tout le monde s’accorde à dire que le Sénégal est un Etat de droit. Et cela a, forcément, des conséquences sur la situation des droits de l’Homme. Mais, ceci ne doit pas nous pousser à être passifs, parce que nous avons énormément de choses à faire.
En tant que militant de l’Alliance pour la République (Apr), votre nomination à la tête du CSDH avait soulevé beaucoup de controverses. Etes-vous, aujourd’hui, en l’aise à ce poste?
Oui, je suis très en l’aise à ce poste. Parce que, je suis un homme du sérail. D’ailleurs, je n’ai pas attendu d’être à la tête du Comité pour défendre les droits de l’homme. C’est une option que j’ai prise, depuis fort longtemps.
Comment se porte le CSDH?
Il se porte à merveille. Je viens d’Abuja où je participais à l’Assemblée générale des institutions nationales des droits de l’homme de l’espace Cedeao. Et je me prépare à aller à Abidjan pour une rencontre des institutions nationales de l’espace Uemoa, mais aussi à Banjul dans le cadre du Réseau international des institutions nationales des droits de l’homme. En un mot, nous sommes en train de remplir la mission qui nous a été confiée par le président de la République.
Combien d’activités avez-vous déroulé ?
Nous en avons déroulées plusieurs. Quand je suis venu à la tête du Csdh, j’ai trouvé qu’il avait déjà mis en place, avec d’autres acteurs de la société civile, l’Observatoire national pour le respect des droits humains dans le domaine extractif. L’option vise à réconcilier la présence des industries extractives avec le respect des droits de l’homme. En mars dernier, nous avons organisé un atelier de deux jours sur le renforcement des capacités des membres du Comité.
Ceci pour qu’ils puissent se familiariser avec un certain nombre de mécanismes et d’instruments régionaux, sous-régionaux, sur la vision minière africaine. Récemment, nous avons été à Rufisque pour accompagner notre antenne départementale. Et notre mission, c’est de faire la promotion des droits de l’homme par l’éducation, de promouvoir la protection dans le but d’attirer l’attention de l’autorité. Depuis décembre 2012, le CSDL a été rétrogradé au statut B par le Comité international de coordination, à travers le sous-comité d’accréditation pour les institutions nationales des droits de l’homme. On aussi les principes de Paris qui édictent des directives comme le recrutement de personnel autonome. Quand le Président Macky Sall est arrivé au pouvoir, il a augmenté le budget du Comité.
Quel est le montant de votre budget de fonctionnement ?
C’est un budget annuel de 50 millions de F Cfa. C’était 36 millions de F Cfa avant l’accession du Président Macky Sall au pouvoir. Certes, l’augmentation est salutaire. Mais, nous demandons plus.
Combien?
Quand on demande, on dit plus. Même si on nous donnait 2 milliards de F Cfa, on allait prendre. Parce que les droits de l’homme n’ont pas de prix. Si vous y mettez des milliards, vous devez retenir que c’est à juste raison. Moi, mon combat, c’est de tout faire pour que le Comité retrouve son statut A. Nous avions trouvé un projet de réforme de la loi 97 relative au CSDL que nous avons repris dans l’objectif de le redynamiser. Le deuxième combat que nous menons pour arriver au statut A, c’est le Plan stratégique que nous sommes en train d’élaborer. Presque, nous sommes en phase terminal.
Que dit ce plan?
Il vise à définir les grandes orientations du Comité sur une période bien déterminée de trois ou quatre ans. Chaque année, le CSDL doit présenter un rapport au chef de l’Etat. Malheureusement, de 2000 à 2012, il a vécu un véritable ostracisme de l’Etat. Presque, il a été inexistant. Aucun rapport n’a été présenté dans ce sens. Ainsi, pour tourner cette page, nous sommes en train de travailler sur le rapport de 2013-2014, mais également celui de 2015-2016.
Quelle est, de manière ramassée, la teneur de ces deux rapports dont vous faites état ?
Nous sommes en phase d’élaboration de ces deux rapports. Même s’ils étaient prêts, selon les textes, la primeur est laissée au président de la République. Il est important, en tant qu’autorité, qu’il soit au courant de la situation des droits de l’Homme au Sénégal à travers le rapport du Comité. Il ne sert à rien de travailler, de mener des activités, alors que vous ne présentez pas de rapport qui va constituer un miroir pour les autorités. Nous allons décrire la situation globale des droits de l’Homme au Sénégal, faire des recommandations.
Avez-vous déjà fixé une date pour les présenter ?
Je ne veux pas donner de date pour dire qu’ils seront publiés à telle période. Si tout va bien, pour le rapport 2015-2016, nous souhaitons le présenter avant la fin de l’année.
PAPE NOUHA SOUANE


























