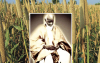Le petit commerce qui fait respirer Saint-Louis

Cette année, la canicule a battu des records de longévité et de pics dans la région Nord. Sous un soleil implacable, la vieille cité tricentenaire vit au rythme d’une chaleur suffocante. Au niveau des points stratégiques, sur les grandes avenues, aux abords des stades, des marchés, des plages et des garages, un ballet incessant attire les regards : celui des femmes vendeuses d’eau glacée et de jus de fruits locaux. Elles sont devenues, malgré elles, les véritables héroïnes de cette saison torride, portant sur leurs épaules un commerce aussi vital qu’informel, aussi éreintant que rentable.
En parcourant la ville tricentenaire, difficile de ne pas croiser ces femmes vendeuses d’eau et de jus locaux, glacières sur la tête ou chariots en plastique à la main, criant pour attirer les clients. Leur présence fait désormais partie du paysage urbain saint-louisien, au même titre que les pirogues le long de la berge du fleuve ou le pont Faidherbe. « On dit souvent que les femmes ne font que vendre de l’eau. Mais le rafraîchissement de la ville repose sur nos frêles épaules. Sans nous, Saint-Louis aurait soif », déclare Sokhna Ami, dans un grand éclat de rire.
Il est onze heures passées au garage Bango, près du commissariat central de la police de Sor, sur l’Avenue Moustapha Malick Gaye. Le thermomètre frôle déjà les 38 degrés. Sous un vieux parasol d’une marque de téléphonie, une dame d’une trentaine d’années arrange avec soin ses sachets d’eau glacée dans une grande glacière bleue. À côté d’elle, d’autres glacières et une bassine de bouteilles de jus de bissap, de pain de singe (bouye) et de gingembre sont bien disposées et couvertes de petits glaçons. « Saint-Louis connaît des températures inhabituelles cette année. Il fait excessivement chaud. Les chauffeurs, les élèves, les passants, les passagers, tout le monde a soif et envie de prendre quelque chose de frais. Quand la chaleur monte, je peux vendre plus de cinq glacières d’eau glacée et des centaines de bouteilles de jus par jour », confie la dame Y. Dia, ajustant son foulard de tête.
Habitant le quartier Diamaguene, dans le faubourg de Sor, non loin du garage Bango, Y. Dia débute sa journée très tôt. À six heures, elle achète des blocs de glace chez des voisines, prépare ses jus à la maison et rejoint son point de vente avant huit heures. À l’en croire, l’investissement de départ est modeste — environ 10 000 F CFA par jour —, mais ses recettes peuvent tripler en période de forte chaleur. « Avant de m’investir dans le commerce de l’eau glacée et des jus de fruits locaux, je travaillais comme bonne dans une maison. Je gagne mieux maintenant qu’en travaillant comme domestique. Et je ne suis plus sous les ordres de personne », lance-t-elle fièrement.
Une économie féminine discrète mais dynamique
Au-delà de l’eau glacée, les vendeuses valorisent aussi les produits du terroir. Dans leurs bouteilles en plastique recyclées, les couleurs du Sénégal s’invitent avec le vert tendre du ditakh mélangé à la menthe, le jaune vif du gingembre et le rouge du bissap. Postée à la porte de sortie du garage menant directement sur la rue Thierno Iyane Sy, la vendeuse O. Thiané, la quarantaine bien révolue, explique comment elle prépare ses jus dans des bassines en aluminium. « Je fais tout à la main. Je lave proprement les feuilles, je les fais bouillir, je filtre avant de sucrer. Mon secret, c’est le dosage. Les clients veulent que ce soit bien frais et bien fait », déclare Mère Thiané, comme l’appellent affectueusement les clients. En cette période de chaleur extrême, les ventes explosent. Chauffeurs de taxi, apprentis, marchands ambulants et même passants s’y ruent pour quelques pièces. « Avec 100 ou 200 francs, on se rafraîchit selon la saveur et la taille de la bouteille et on reprend des forces », dit un jeune mécanicien rencontré à la place Mère Thiané, avant d’ajouter que « c’est naturel, ce n’est pas comme les boissons industrielles ».
À Saint-Louis, difficile d’estimer le nombre exact de femmes engagées dans ce commerce. Elles sont des milliers à exercer dans la restauration de rue. Leur présence se remarque à chaque coin de rue : près des stades, où les supporters achètent des sachets d’eau glacée avant les matchs ; dans les marchés, où elles se faufilent entre les étals ; sur les plages ou encore le long des grandes avenues, où les automobilistes s’arrêtent brièvement pour s’approvisionner.
« Sans ces femmes, beaucoup de travailleurs souffriraient de déshydratation. Elles jouent un rôle social essentiel », estime le commerçant Mamadou Fall, établi au marché Sor. Ce commerce est aussi un refuge économique. Nombre d’entre elles sont des mères de famille, parfois veuves ou divorcées, qui trouvent là une activité génératrice de revenus stable, sans besoin de diplôme. « Je suis veuve depuis février 2018 et je vends depuis quatre ans. Grâce à ce commerce de l’eau glacée et des jus de fruits, je paie la scolarité de mes deux jeunes enfants. Même quand les temps sont durs, je ne reste jamais sans rien faire », témoigne Nd. Astou.
L’eau glacée et les jus locaux : un commerce qui fait vivre la ville
Mais derrière les sourires et la débrouillardise, le quotidien est rude. Sous des températures pouvant atteindre près de 40 degrés à l’ombre, ces femmes passent des heures debout, exposées au soleil, respirant la poussière et supportant le poids de leurs glacières. « La chaleur est notre pire ennemi, mais c’est notre gagne-pain. Quand il fait trop chaud, la glace fond vite, les jus perdent leur fraîcheur. Parfois, je dois racheter de la glace deux fois dans la journée », explique une vendeuse installée au rond-point du quai de pêche de Diamalaye. Pour faire face à ces problèmes de conservation, certaines utilisent désormais des techniques ingénieuses pour couvrir leurs glacières. Mais tout cela a un coût. « Le prix du bloc de glace a augmenté. Avant, c’était 100 francs, maintenant c’est 150. Les vendeurs de glace évoquent la cherté de l’électricité. Et quand il y a rupture, on perd la moitié de la journée », se plaint-elle.
Avec l’effet des changements climatiques, au fil des années, ce petit commerce de rue s’est transformé en un véritable réseau économique local. Autour des vendeuses d’eau et de jus gravitent plusieurs autres acteurs : fournisseurs de blocs de glace, vendeurs de sachets plastiques et de bouteilles recyclées, fournisseurs de fruits et petits revendeurs. Ce secteur, à la fois modeste et vital, représente un levier d’emploi majeur dans la ville. Le commerce informel de l’eau et des jus générerait plusieurs millions de francs CFA chaque mois à l’échelle de la région. Les stades et les garages constituent les points les plus lucratifs. Lors des rencontres sportives, la demande explose. Les vendeuses affluent dès les premières heures de l’après-midi pour occuper les meilleurs emplacements. « Un jour de match, je peux écouler des centaines de sachets d’eau fraîche avant la mi-temps. Avec la forte chaleur qui sévit présentement à Ndar, je vends l’eau glacée à 50 francs le sachet, comme des petits pains », soutient A. Seck. Les chants des supporters, les tam-tams et les appels des vendeuses forment un décor sonore où l’eau glacée devient un produit aussi stratégique qu’un billet d’entrée.
Et dans les garages, l’ambiance n’est pas moins animée. « Quand les chauffeurs se préparent pour de longs trajets vers les régions lointaines comme Kaolack, Touba ou Matam, ils se ravitaillent en bouteilles de jus grand modèle à 1 000 francs CFA. Ici, nous avons une clientèle fidèle, surtout les apprentis », explique F. B. Gueye, vendeuse à la gare routière de Sor.
Malgré leur dynamisme, les vendeuses manquent d’accompagnement financier
Même si le succès de ces vendeuses ne fait aucun doute, plusieurs défis se posent, dont l’hygiène, la conservation des produits, la gestion des déchets plastiques et surtout la reconnaissance économique de leur travail. « Elles sont invisibles dans les politiques publiques, alors qu’elles jouent un rôle de santé publique. Elles fournissent un service essentiel dans un contexte de réchauffement climatique », note le sociologue Alioune Diop, avant d’inviter à une meilleure organisation du secteur par des formations en hygiène et sécurité alimentaire. Derrière ce dynamisme se cachent également de nombreuses difficultés, notamment le manque de moyens financiers. Beaucoup de femmes vendeuses peinent à accéder à des équipements de conservation comme les réfrigérateurs ou les glacières modernes indispensables pour maintenir leurs produits au frais toute la journée. « Si j’avais un frigo, je pourrais produire plus et conserver mes jus plus longtemps. Mais avec mes petits revenus, c’est impossible d’en acheter », confie Sokhna Ami.
Les besoins en fonds de roulement se font également sentir. Entre l’achat des fruits, des intrants, des sachets et de la glace, le capital nécessaire au démarrage ou au renouvellement des stocks reste difficile à mobiliser. Faute d’accès aux crédits dans les mutuelles d’épargne, la plupart dépendent de tontines ou d’aides familiales. « Nous travaillons dur, mais nos moyens sont limités. Si on nous soutenait avec de petits prêts, on pourrait mieux développer nos activités », ajoute O. Thiané. De nombreux acteurs appellent aujourd’hui à une meilleure inclusion économique de ces entrepreneures de rue, à travers des programmes de microfinance adaptés et un accompagnement des autorités locales. Car, malgré la précarité de leurs moyens, les femmes vendeuses continuent de faire vivre la ville.
IBRAHIMA BOCAR SÈNE — SAINT-LOUIS