Le Sahel mise sur l’élevage pour renforcer la résilience
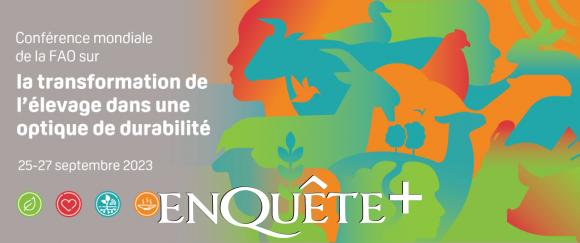
Alors que la FAO réunit à Rome, du 29 septembre au 1er octobre 2025, les acteurs mondiaux de l’élevage durable, le Sahel se trouve à la croisée des chemins. Dans une région où l’élevage représente jusqu’à 40 % du PIB agricole et fait vivre des millions de familles, les choix politiques et financiers détermineront si les populations s’orientent vers la résilience ou restent prisonnières de la fragilité.
Alors que la FAO organise sa Conférence mondiale sur la transformation durable de l’élevage à Rome, du 29 septembre au 1er octobre 2025, le Sahel se retrouve face à un tournant décisif. La région, où l’élevage est vital pour des millions de familles, doit transformer ses engagements en actions concrètes afin de renforcer l’inclusion, la santé animale, l’alimentation et l’accès aux marchés pour les femmes et les jeunes. « Dans une région où l’élevage est vital, les choix posés aujourd’hui détermineront si des millions de familles s’orientent vers la résilience ou restent piégées dans la fragilité », souligne le directeur régional pour le Sahel à Heifer International, Idrissa Ba.
Un secteur vital mais vulnérable
Dans des pays comme le Niger, le Mali ou le Tchad, l’élevage contribue jusqu’à 40 % du PIB agricole et fait vivre des millions de ménages. L’Afrique de l’Ouest et le Sahel comptent plus de 112 millions de bovins, 170 millions de moutons et 224 millions de chèvres, une richesse immense mais encore sous-exploitée. Pourtant, la productivité reste faible, freinée par les chocs climatiques, la dégradation des terres, les maladies et l’insécurité. Les femmes et les jeunes, majoritaires dans le secteur, se heurtent aux obstacles les plus lourds : manque d’accès à la terre, au financement et aux services vétérinaires.
À Thiès, au Sénégal, l’Initiative des maires pour l’autosuffisance en moutons, portée par Heifer International, illustre l’impact des solutions locales. Avec formation, appui vétérinaire et accès au marché, Anta Gueye a transformé son troupeau en source durable de revenus et de nourriture. « Autrefois, ma famille dépendait de l’achat d’animaux. Désormais, nous élevons les nôtres, ce qui apporte dignité et résilience », témoigne-t-elle. L’initiative a déjà soutenu plus de 30 000 familles d’éleveurs, dont 85 % de femmes, qui font état d’une amélioration de leurs revenus et de leur sécurité alimentaire. De son côté, le Programme régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), soutenu par la Banque mondiale, a touché plus de 2,2 millions de pasteurs grâce à des campagnes de vaccination, des points d’eau et des infrastructures de marché. La CEDEAO a, elle aussi, fait du pastoralisme une priorité de sa politique agricole régionale.
Alors que les débats climatiques tendent à présenter les pasteurs comme des acteurs polluants, Idrissa Ba plaide pour un changement de regard : « En restaurant les pâturages, en adoptant des aliments améliorés et en gérant durablement leurs troupeaux, ils réduisent les émissions et protègent les écosystèmes tout en nourrissant leurs familles. La justice exige de soutenir leur résilience, et non de les pénaliser pour des émissions qu’ils n’ont pas créées. »
Trois priorités pour l’avenir
Idrissa Ba appelle les dirigeants à avancer sur trois chantiers majeurs. Il les invite à fixer des objectifs clairs en matière de genre et de jeunesse, avec un accès égal à la terre, aux financements et aux services. Il attend que l’on renforce les infrastructures et la santé animale, en multipliant les parcs de vaccination, les points d’eau et les outils de gestion des risques comme l’assurance bétail. Enfin, il souhaite que soient améliorés les systèmes de données, afin de mieux cartographier les routes de transhumance et suivre les résultats selon le genre et l’âge.
Pour Idrissa Ba, le Sahel n’a plus le luxe d’attendre. En effet, soutient-il, « ce n’est plus le moment des déclarations générales. L’avenir du Sahel dépend de la solidité de son secteur de l’élevage et des populations — femmes, jeunes et pasteurs — qui le font vivre ». Selon lui, investir dans la santé animale, l’alimentation, l’accès aux marchés et à la terre représente bien plus qu’une stratégie agricole : c’est un pari pour la stabilité, la dignité et la croissance de toute la région.
MAGUETTE NDAO

























