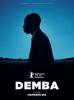‘’Il faut travailler sur la distribution du cinéma en Afrique’’

Nouveau directeur du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), François Akouabou Adianaga a pris part à la 5e édition du festival Image du fleuve de Boghé, en Mauritanie. Une occasion saisie par ‘’EnQuête’’ pour s’entretenir avec le successeur d’Alex Moussa Sawadogo (nommé DG d’ABCA) sur ses visions et ambitions, mais aussi sur les défis du cinéma africain, entre autres.
Vous êtes le nouveau directeur du Fespaco, l'un des plus grands festivals du cinéma africain. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature ?
Je pense que c'est la confiance que mon directeur général Moussa Alex Sawadogo (DG de l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel) a eue en moi. Et il a donc soumis la demande au ministère, notamment au secrétaire général et au ministre qui ont validé. Et voilà, donc je pense que c'est basé sur la confiance et aussi peut-être le parcours que j'ai eu au Fespaco. Parce que j’y suis depuis 2010 et donc j'ai acquis assez d'expérience. Et il a estimé que je pouvais donc remplir ces fonctions. Et il m'a fait nommer donc directeur du Fespaco.
Quelles sont vos priorités? Est-ce qu'il y a des innovations que vous comptez apporter ?
Nous avons entamé des innovations avec Alex Moussa Sawadogo (ex DG du Fespaco) depuis 2021. Et je pense que ce sont ces innovations-là qu'il faut qu'on renforce avant de penser à d'autres perspectives. Renforcer ces innovations, consiste à travailler à ce que la sélection soit toujours de qualité. Ensuite, travailler à ce que les ateliers Yennenga soient renforcés. Il faut aussi professionnaliser le MICA. Nous voulons mieux organiser la tenue des rencontres professionnelles (ateliers, masterclass, panels.
Comment comptez-vous renforcer le succès de ce grand rendez-vous en Afrique et dans le monde ?
Déjà, participer à des festivals comme celui de Fif (Festival image du fleuve), c’est renforcer justement le rayonnement du Fespaco. Et aujourd'hui, on est présent dans beaucoup de pays, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud. Et même dans les festivals africains qui se retrouvent en Europe ou en diaspora, au Brésil, au Canada également, on est présent.
Et on essaie donc à chaque fois qu'on a l'occasion de participer à ces festivals-là, de faire rayonner le Fespaco, et le cinéma d'Afrique. Après, on essaie aussi de faire en sorte que le Fespaco demeure la vitrine du cinéma africain, et soit la grande messe du cinéma africain. Tous les deux ans, on fait en sorte que tous les cinéastes n'aient qu'une seule destination: venir au Fespaco. Donc je pense que toutes ces actions que nous menons participent au rayonnement du Fespaco et du cinéma d'Afrique.
Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels le cinéma africain fait face ?
Le cinéma africain a un souci de financement, mais aussi un véritable problème de distribution. Il n'y a pas assez de financement, mais le cinéma se développe; il y a des productions toute l'année.
Par rapport au problème de la distribution, on n'a pas beaucoup de spécialistes en distribution de nos films. Aujourd'hui, nous, à travers la Fédération panafricaine des festivals de cinéma, on veut travailler à ce que les films soient beaucoup distribués dans les festivals. Après, pour la distribution des films en salles ou sur les plateformes, c'est un autre combat.
Mais il faut forcément qu’on puisse travailler sur la distribution du cinéma en Afrique. C'est un des défis que le Fespaco ou tout autre festival ou tout autre cinéaste doit prendre à bras le corps pour que les productions soient vues et puissent favoriser un retour sur l'investissement.
Justement, par rapport à la distribution des films, comment le Fespaco peut-il aider à améliorer leur visibilité ?
Déjà, en projetant les films au festival, on les présente à tous les professionnels: chaînes de télévision, plateformes numériques, et distributeurs. C'est pour permettre à ces professionnels qui arrivent au Fespaco de faire des choix de films et de pouvoir rencontrer les réalisateurs. Parce qu'on a aussi cette force-là de faire venir les réalisateurs de tous les films qui sont en compétition et les producteurs suivent. Et donc, les diffuseurs ou distributeurs peuvent justement prendre contact avec ces personnes-là, s'ils passent à Ouagadougou pour conclure des contrats de distribution. Je pense que c'est ce que le Fespaco fait et on va continuer de le faire.
Quelle place occupent les jeunes au Fespaco ?
Comme je dis, en 2021, on a commencé avec Alex, les ateliers Yennenga, structurés en trois axes. Le premier, c'est celui de Yennenga Academy. Cet axe est un appel qu'on va lancer pour permettre aux jeunes qui ne sont pas forcément cinéastes, qui n'ont pas fait d'école de cinéma par exemple, mais qui sont intéressés par le cinéma, à la photographie, à l'image, au son, qui a même peut-être fait un peu d'actorat. Quand le jeune nous envoie son CV, on regarde... En acceptant sa candidature aux ateliers Yennenga Academy, on essaie de l'orienter vers un métier… Donc Yennenga Academy est vraiment un centre d'incubation. Et ça, c’est pour les jeunes de l'Afrique et de la diaspora. L'année dernière, en 2025, on a fait venir 22 jeunes. Et quand tu regardes le rapport qu'eux-mêmes ont produit, il est très éloquent, encouragé, satisfaisant.
Après, nous avons aussi l’aspect concernant la production. On va ouvrir Yennenga co-production pour permettre justement à vous, par exemple, qui avez un projet de réalisation de film, de pouvoir rencontrer des coproducteurs à Ouagadougou et de pouvoir faire un contrat ensemble pour pouvoir financer la production du film. Ça aussi, on le fait avec une dizaine voire une quinzaine de cinéastes et de professionnels. Et c'est des projets qui aboutissent et qui reviennent souvent au Fespaco en compétition ou qui vont dans d'autres festivals en compétition.
Après, nous avons le troisième atelier qui est Yennenga postproduction, qui permet justement à vous qui avez fini votre projet, mais vous avez des difficultés pour financer la postproduction, de venir à Ouagadougou et de rencontrer des fonds qui vous permettent de finir le projet en postproduction. Donc voilà comment, d'une manière générale aussi, le Fespaco a innové et permet d'accompagner les productions des jeunes de manière générale.
La nouvelle génération, de façon générale, consomme le cinéma, des courts-métrages surtout, à travers les réseaux sociaux. Que pensez-vous de cela?
Oui, aujourd'hui la question des réseaux sociaux pose peut-être un problème, mais c'est ce que Sissako a dit quand il a présenté les téléphones d'aujourd'hui. Il a dit que les téléphones nous avilissent parfois, mais on peut les utiliser pour promouvoir le cinéma. Aujourd'hui, il y a des plateformes numériques qui permettent à tout le monde, partout où l’on se trouve, pourvu qu’il ait une connexion internet pour voir des films. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, je pense qu'il faut maintenant qu'on travaille aussi dans le contenu. Qu’est-ce qu'on veut montrer à l'image ? Qu'est-ce qu'on veut montrer quand on fait un film ? Il faut que le message que nous souhaitons transmettre soit transcendant. Nos productions doivent être authentiques et refléter fidèlement les réalités que nous vivons. Ainsi, ces représentations ne constitueront ni une aliénation ni un appauvrissement pour nous, les héritiers de cette culture... Il s’agit au contraire d’incarner notre identité et notre patrimoine. De cette manière, l’ensemble de la communauté en tirera bénéfice. Aujourd’hui, chacun possède un téléphone. Certains festivals fondent même leur sélection sur des films tournés avec cet outil – sous réserve de critères précis. Selon moi, une prise de conscience déterminée s’impose chez les jeunes cinéastes : ils doivent s’emparer de thématiques percutantes.
Le Fespaco est aussi un espace de débat des problèmes politiques et sociaux. Aujourd'hui, quelle place occupent ces grandes questions-là ?
Le Fespaco a toujours ouvert un cadre d'échange et de réflexion qui s'est renforcé, qui s'est dynamisé. Depuis quelques années, on fait un appel à texte sur un thème principal sur lequel on veut discuter. Et ce thème est généralement choisi en collaboration avec la Fédération panafricaine des cinéastes, avec nous-mêmes, notre Fédération nationale des cinéastes, avec d'autres mentors, d'autres aînés qui nous aident à trouver le thème. Parce que le thème découle généralement de leurs préoccupations…
Et ce qui est intéressant, c'est que les participants viennent de partout. Ils viennent même du continent européen, du continent américain, de la diaspora, et du continent africain. Et ils partagent leur expérience. C’est là où nous mettons en synergie les professionnels sur le terrain avec les anciens chercheurs en cinéma. Donc, c'est comme si nous attachions le fil de la théorie à celui de la pratique. Et donc, généralement, les actes qui sont produits sont très pragmatiques. En tout cas, ils nous apprennent autant sur la théorie que sur le développement ou la production de film. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et le colloque, généralement, reste au cœur du Fespaco et se tient sur deux jours. Après ça, il y a d'autres conférences thématiques ou professionnelles qui permettent justement de discuter aussi d'autres questions de manière pratique.
On a discuté l'année dernière sur la musique dans le film. On a discuté à travers des masterclass, des personnes qui ont fait des masterclass sur la production du cinéma, sur la question du cinéma comme business. Donc, il y a plein de réflexions comme ça qui sont menées et qui permettent d'accorder, en tout cas, une plus-value au festival, mais qui permettent de renforcer aussi les professionnels.
Comment percevez-vous les grands cinéastes sénégalais comme Ousmane Sembène, Djibril Diop Mame Betty?
Sembene Ousmane, Djibril Diop Mambety, Samano Vira, toutes ces personnes-là sont une source d'inspiration pour nous. Ils l’ont été et continuent de l’être. Quand vous rentrez dans la cour du Fespaco, vous avez le monument de Soumano Vira, vous avez celui de Sembene Ousmane. Ils sont là pour dire aux jeunes qui arrivent qu'il y a des gens qui ont fait des choses. Voilà, il y a des gens qui ont fait des choses. Et qu'eux, aujourd'hui, ils ont l'obligation d'aller regarder ce que ces personnes-là ont fait avant de pouvoir parler du cinéma. Parce qu’ils sont les pères fondateurs, aujourd'hui, du Fespaco.
Sembene Ousmane, Tahachiria, Alimanta Salabiri, des gens qui ont donné tout pour le cinéma africain. Et ils sont pionniers. Et aujourd'hui, nous, notre regard se porte vers eux, parce qu'ils nous ont inspirés. Et ils ont inspiré beaucoup d'autres réalisateurs.
Djibril Diop, j’ai suivi beaucoup ses films. J'ai même vu un de ses films qui a été fait en ciné-concert. C'est beau. Aujourd’hui, quand on regarde toutes ces histoires qui ont été traitées de manière professionnelle, artistiquement très bien faites, avec des prises de position qui ont permis aujourd'hui à notre cinéma d'aller, de grandir. Ça nous a permis de nous affranchir. Je donne l’exemple des films comme ´La Noire de ´´, ´´ Le Mandat’´, etc.
Il y a beaucoup de productions comme celles qui ont permis aujourd'hui aux Africains de s'affirmer et de s'afficher, d'être fiers de leur africanité. Donc on ne peut que les remercier pour ce qu'ils ont fait et continuer de s'abreuver à leurs sources, pour une Afrique plus épanouie, avec des événements culturels majeurs, tels que la biennale d'art africain.
Envisagez-vous des partenariats entre le Fespaco et de grandes initiatives culturelles sénégalaises?
Oui. On va dire, déjà, les liens entre le Burkina et le Sénégal sont très forts. En termes séculaires, en termes humains, en termes de productions cinématographiques. À travers le Fopica, il y a eu beaucoup d'impact sur le cinéma du Burkina. Je me rappelle que ´´ Sira ´´ d'Apolline Traoré a bénéficié d'un appui du Fopica. Et il y a beaucoup d'autres projets. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont en formation à Dakar, à travers des projets tels qu’Upcourt. Donc ça, c'est déjà très important. Au-delà de ça, nous avons des collaborations avec la Biennale de Dakar. On a aussi une collaboration avec le Festival des Femmes de Dakar, mais aussi avec le Teranga de Dakar et Dakar Court. Il y a beaucoup de collaborations entre les festivals à Dakar et le Fespaco. Ce sont des relations qui vont se renforcer.
Vous avez pris part à la 5e édition du Festival Image du fleuve (Fif) de Boghé, en Mauritanie. Comment appréciez-vous cet événement ?
Je félicite le promoteur Djibril Diaw pour cette audace. Parce que lorsque tu pars de rien pour faire un festival, ce n'est pas toujours évident. Mais quand tu es convaincu de ce que tu fais, je pense qu'après, les autres vont te suivre. Il a lancé son festival un peu comme le train qui passe. Sans savoir si les rails sont très bien, si le train même va arriver. Mais après, les gens vont s'accrocher. On va aller ensemble; on va réparer au fur et à mesure. On va construire au fur et à mesure. Et qui sait, peut-être dans dix ans, le Festival Image du fleuve sera quelque chose d'incontournable au niveau de l'Afrique. C'est quelque chose que nous saluons, nous encourageons. C'est pourquoi on est là pour témoigner de notre solidarité et de notre soutien à ce festival-là. Nous demandons aussi à toutes les personnes qui peuvent nous accompagner de le faire.
Parce que vous voyez, la jeunesse aujourd'hui, dans quelques contrées qu'elle se retrouve, a besoin d'espace pour s'affirmer, d'espace de référentiel, de miroir pour se regarder. Et le cinéma constitue ce tremplin-là. Tout comme d'autres activités.
À Boghé, quand les jeunes partent au stade pour voir un match de football, tout devient calme. Ça veut dire que tout le monde est orienté vers le football. Aujourd'hui, le festival Image du fleuve draine des jeunes, draine des personnes. On a vu la parade au fleuve où toutes les couches sociales étaient représentées. Elles sont sorties massivement pour communier. Ça c'est des choses qui sont très importantes. Et lorsque l'on est dans une zone comme ça, je pense que des activités comme le festival Image du fleuve sont les bienvenues. Ils méritent d'être soutenus. Je propose que le festival devienne annuel au lieu d'avoir lieu tous les deux ans, et qu'il dure une semaine complète plutôt que seulement 3 ou 4 jours.
Parce que l'impact ou les effets de ce festival-là sont déjà visibles. Ce festival peut apporter un changement de comportement. Il peut apporter plus de responsabilités aux jeunes. Ce festival peut amener les jeunes à être beaucoup plus conscients. Ce festival peut les inciter à mesurer des actes ou des actions de développement de la localité et du pays. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour promouvoir le développement de la localité et de la région. Donc à mon avis, il a besoin que les autorités le soutiennent et le soutiennent fermement.
Votre mot de la fin…
Vous-même, vous êtes venus très nombreux. Quand des gens quittent chez eux pour venir chez vous, il n'y a pas de raison que vous-même ne participez pas à l'activité. Vous êtes venus très nombreux et ça, c'est quelque chose que je salue et qui me touche vraiment. Et ça vient de montrer que si des gens sont venus de chez eux pour vous accompagner, il n'y a pas de raison que vous-même ne vous accompagnez pas. Parce que chez nous, on dit : quand tu croises quelqu'un au bord du marigot, qui a son canari sur les genoux et cherche à le remettre sur sa tête, laisse tout ce que tu es en train de faire et aide-le à replacer l'oiseau sur sa tête. Et vous êtes venus, donc vous avez apporté le festival sur les genoux. Il faut maintenant que la population des Boghé, que toute la Mauritanie l'aide à porter ce canari sur la tête.
BABACAR SY SEYE (ENVOYÉ SPÉCIAL)